
La Néréide Galatée dans les bras du berger Acis, fils du dieu Pan, fontaine Médicis, jardin du Luxembourg, octobre 2017
La voix modèle ou les regardés regardant

Sur la sellette, recueil de nouvelles d’Annie Ferret, L’Harmattan, 2015
Modèles vivants : tous les acheteurs d’art, les habitués des musées, centres culturels et galeries admirent leurs représentations.
Sur la sellette, le recueil de nouvelles d’Annie Ferret joue des ambiguïtés de cette activité de l’ombre de la création artistique, pratiquée dans les écoles, les académies et les ateliers d’artistes, et sans laquelle le patrimoine culturel serait bien maigre.
Cette première fois à la Grande chaumière, il y a trente-cinq ans, Loumia se l’était figurée comme une chose extraordinaire. Axelle, une de ses amies de l’époque, beaucoup plus âgée qu’elle, l’y avait introduite. Elle avait vanté l’endroit, fidèle à la réputation qu’on lui faisait, prétendait-elle. C’était un peu le temple du dessin de modèle vivant, tu te rends compte Loumia. Les plus grands avaient passé là, y avaient professé même, comme Bourdelle, Fernand Léger, Ossip Zadkine, Jacques-Émile Blanche. La liste était longue, épaisse, chargée, valait le déplacement. Tu te rends compte Loumia ? Cézanne, Delacroix et Picasso ont participé à sa création, quai des Orfèvres. (p. 76)

La femme aux pommes, Jean Terzieff, (élève de Bourdelle et proche de Brancusi), statue dans le jardin du palais du Sénat, Paris
Cher tout le monde, femmes, hommes et tant d’autres, Constantin Brancusi a dit : « Les choses de l’art sont les miroirs dans lesquels chacun voit ce qui lui ressemble ». Idem pour les modèles vivants.
Chaque jour, Ida arrivait, se glissait derrière son paravent, ses appartements, comme elle disait, enfilait une paire de mules, une tunique bleu pâle, le même depuis seize ans, et elle émergeait du paravent au bout de quelques minutes à peine. (p 38-39)

Allégorie de la Vérité du monument à Auguste Scheurer-Kestner par Aimé-Jules Dalou, jardin du Luxembourg. Sénateur de l’Alsace occupée, vice-Président du Sénat français, Scheurer-Kestner fut le premier homme politique à croire en l’innocence du capitaine Alfred Dreyfus
Est-ce parce qu’elle consiste en la monstration du corps dévêtu, dans les lieux d’élaboration de l’art, qu’elle est à la fois visible et invisible, évidente et indéfinissable, ritualisée et insolite, que cette activité est volontiers fantasmée ?
Bientôt dix-sept années que Georges la voyait nue chaque jour sans jamais l’avoir touchée. Il ne la voyait pas, il ne regardait que la lumière. (p. 44)

Annie Ferret par Olivier Juanard, acrylique sur papier, 2015, facebook.com
De cette vocation associée à la passivité quel est le pouvoir ? La jouissance irréductible ? Le plaisir où la majorité serait submergée par l’inconfort ? Bref, l’essentielle activité ?
Elle n’était pas pressée, bien sûr, elle en profitait pour s’étirer, parce ses membres lui faisaient mal, mais moins qu’elle aurait cru, sans doute grâce aux flatteries qui nourrissaient son propre orgueil et son propre contentement. (p. 127)

Annie Ferret, Paris, octobre 2017
À la lecture du recueil d’Annie Ferret, on conçoit qu’activité est le terme juste et que le sens commun ignore les intentions du modèle vivant et les nuances de son vécu en chair et en os. Qu’il s’en forge une idée éloignée de la réalité, aussi fantasmagorique que les figures de fou ou d’orphelin de la littérature et du cinéma.
En seize années, seuls les chaussons avaient changé deux ou trois fois. Elle grimpait sur la sellette en prenant appui sur des deux mains sur un genou. Cinquante centimètres du sol, ce n’était pas grand-chose, mais c’était fou comme ça lui paraissait plus haut qu’avant, de plus en plus haut avec les années. C’était à ça qu’elle mesurait qu’elle était en train de vieillir, et une fois là-haut seulement, elle se débarrassait de la tunique qu’elle pliait ou qu’elle laissait en boule, selon son humeur, sur un tabouret bas, laissé exprès pour ça à côté de la sellette, entre les deux calorifères. Elle prenait la pose et l’on commençait. (p. 39)

La Peinture de Jules Franceschi, allégorie sur la façade de l’Orangerie, jardin du Luxembourg, Paris
Sur la sellette transporte de l’autre côté du miroir, à la latitude de l’art en chantier, et quel chantier ! dans le périmètre duquel se côtoient professionnels et amateurs, se coudoient modèles, artistes, enseignants et étudiants…
Il se souvenait d’une période de sa vie d’enseignant, à ses débuts, où les personnalités les plus exubérantes l’amusaient plus que tout. Pour le modèle intéressant, il était prêt à renoncer au bon modèle. C’est-à-dire qu’il pardonnait volontiers à un modèle de mal poser, de bouger tout le temps, de ne pas connaître suffisamment les limites de son propre corps, pourvu qu’il soit quand même un personnage de roman. Aujourd’hui, peut-être en vieillissant, il considérait depuis longtemps le côté original, extraverti, l’exubérance la plus folle, comme un plus parfois, une fantaisie, une petite goutte d’imprévu, mais il sélectionnait d’abord ceux qui savaient poser et connaissait le métier. (p. 123)
Modèles vivants : qu’en est-il de la chose vive délogée par le discours communément admis sur elle réduite à la dimension d’objet ? À quoi consent le sujet se tenant au vu et précisément pas au su de tout ce monde créatif ? Le sujet demeurant, sur la sellette, à la merci ou la discrétion du regard qui poursuit sa quête dans son corps livré à quoi ?
Ida, bien sûr, était nue, mais Georges ne la voyait pas. Il ne voyait plus Ida, mais son modèle. Ida elle-même, du moins le corps d’Ida, son enveloppe extérieure, disparaissait pendant quarante-cinq minutes. Il n’en restait qu’une voix intermittente et désincarnée, parce qu’ils parlaient peu pendant la pose. (p. 39)

Fleuve (dieu), statue de Francisque Duret, à senestre du fronton de la fontaine Médicis, jardin du Luxembourg
Si Sur la sellette défige l’image du modèle vivant, c’est qu’Annie Ferret exerce cette activité dont elle possède une connaissance subjective des contraintes physiques et psychiques, une intelligence franche et fine du corps posant, qui sait, pour la postérité ou pour manger ou les deux… L’écriture ne se borne donc pas à exploiter l’imaginaire convenu, elle ne brode pas sur la représentation de la représentation, mais trouve sa force en se colletant avec un présent suant et souffrant comparable à un défi sportif.
Elle ne laissait jamais paraître qu’elle avait mal. Elle tournait le dos à la pendule, ne savait plus, mais elle tenait bon. La voix du massier, soudaine et officielle, cria le repos au bout de trois quarts d’heure et vint la délivrer. (p. 77-78)
Enchaîner les poses en tenant sur la longueur, l’exercice n’est pas naturel, mais fruit d’un apprentissage. La séance est une épreuve d’endurance que chaque modèle traverse selon ses aptitudes : expérience, âge, talent… À noter que la morphologie n’est pas celle prisée par la mode.
Loumia est ronde et rose. Cette tendance s’accroît considérablement chaque année, à un rythme régulier. (p. 76)
Des malentendus insistent : modèle vivant est une zone grise, une région de bouleversements de l’allant de soi, d’invention de l’image du corps, de remodelage de soi et de l’autre :
Trop, tard, bien sûr. Louise était perturbée maintenant. C’est bien ce qu’il voulait. Il sourit parce qu’il avait vu qu’il qu’elle n’avait pu s’empêcher à son tour d’examiner ses mains, ses mains à elle, et puis ses mains à lui, maintenant, alternativement. Il savait déjà qu’il avait gagné. (p. 10)

Marie-Stuart (détail), Jean-Jacques Feuchère, jardin du Luxembourg, Paris
Aussi, dans le curieusement nommé Cinq à six, le récit initial du recueil, une chômeuse, lectrice de Bérénice de Racine – son ouvrage-grigri à double tranchant –, accepte-t-elle la proposition de poser en amatrice, histoire, sans doute, pour l’écrivaine de rappeler que oui, oui, modèle vivant est une occupation recelant une part de magie, comme l’inattendu d’un pacte avec la genèse de l’art, pratique, elle-même, par définition inattendue.
Ça avait duré un an et demi, moins trois semaines de vacances à l’été et une l’hiver, où Louis était parti elle ne savait où. Et encore un jeudi où Louise avait été malade. Grippée, au fond de son lit. Le mardi suivant, elle était revenue malgré tout, craignant de ne plus le revoir, si son absence se prolongeait. (p. 14)

La Messagère de Gabriel Forestier, statue en pierre, jardin du Luxembourg, Paris
Dans Cinq à six, le lien modèle amateur-dessinateur semble une métaphore par excellence de la rencontre. La rencontre comme accélérateur de troubles, dont on ne peut, en toute rigueur, rien augurer, prédire les renversements de position ou de posture, le devenir des dynamiques de séduction, d’échange, de don, de rapports de force et d’influence… Un des mérites du recueil est que les ambiances palpables, les descriptions des lieux, les horaires, cadences (en secondes, minutes, quart d’heure) et rituels des séances, les exigences dues ou non des artistes, la rémunération des modèles et leurs efforts éreintants, les illusions, fiertés, gestes trompeurs, de part et d’autre, les enjeux de prestige, les ruses et les refuges qui s’avèrent être des abris pour personne, tous ces éléments précis permettent de sentir ou savoir sans vraiment savoir. Par exemple, l’argent, bien sûr oui, l’argent, le nerf de la guerre, mais bon, pas que… Un flou demeure. Un sentiment d’étrangeté essentielle. De mais qu’est-ce qui se passe… ?

Vénus au dauphin, jardin du Luxembourg, octobre 2017
Modèles vivants : d’aucuns doutent – là-dessus, aussi, un gros soupçon plane – qu’il s’agisse bien d’un métier, exercé à plein temps, ou en complément d’un autre, et dont on tire des moyens de subsistance : ne flirte-t-il pas, comme celui de comédienne ou d’actrice, avec le plus vieux métier du monde ? À ce propos, connaissez-vous Jeanne Duval, la muse de Charles Baudelaire ?
La gardienne avait parlé de deux ou trois hommes qui venaient assez régulièrement la voir et qui étaient toujours seuls. Elle avait insisté sur le toujours seuls, mais ça ne voulait rien dire. Enfin, elle disait ça comme ça, au cas où ça serait important. Elle n’en savait rien. (p. 133)

Calliope, muse de la poésie épique et de l’éloquence, marbre de Fernando Pelliccia, jardin du Luxembourg
Mais il s’agit bien d’un métier avec ses horaires qui ne sont pas de bureaux, ses tarifs à négocier, ses dynamiques de concurrence, ses associations de professionnels et un parfum de légende qui brouille les pistes… Ce métier peu commun, se confond-il avec le rôle de muse ? Pour la mythologie grecque, les muses ont une origine divine : elles sont les neuf filles de Zeus et de Mnémosyne, la déesse de la mémoire, accompagnant Apollon, le dieu de la Beauté, des Arts et de la lumière qui les conduit (d’où son surnom : musagète). Dans un monde hellénique qui mêle étroitement les questions du Beau, du Bien et du Vrai, les muses sont les allégories des arts poétique, rhétorique, lyrique, astronomique, non des arts plastiques.

Berthe de Laon, marbre, d’Eugène Oudiné qui représente la reine de France tenant dans sa main droite une miniature de son fils : Charlemagne, jardin du Luxembourg
Matisse et Lydia Delectorskaya, Bonnard et Marthe, Picasso et la photographe Dora Maar, Giacometti et Caroline, Dali et Gala, van Gogh et Sien Hoorni… Cocteau et Jean Marais, Bacon et Georges Dyer… En appelant muse les inspiratrices et les inspirateurs des artistes, l’imaginaire collectif leur reconnaît cette parcelle de pouvoir divin. Somme toute, une espèce de génie ! Et il en faut pour être tellement acte serviable, à ce point se vouloir au service de… De l’art ? De l’artiste qui, lui-même, est au service de… ?

Velléda contemplant la demeure d’Eudore, marbre de Hippolyte Maindron représentant la prophétesse amoureuse de son geôlier, rendue célèbre par Les martyrs de Chateaubriand
Comment dégager une cohérence ? Où l’énergie des créateurs se déploie, les frontières sont fines comme du papier de riz entre la passion artistique et la passion de l’autre, entre les statuts de modèle, d’amante ou d’amant, de compagne ou de compagnon, de conjoint d’une façon ou d’une autre, de toutes les façons… Ceux dont l’image est la source du processus créatif embrassent le domaine de la confusion à leurs risques et périls. L’ordinaire paradoxal du contrat dramatise le lot de tout un chacun. N’est-ce pas notre part commune que d’avoir les reins suffisamment solides pour encaisser d’être effacé, remplacé, négligé, s’accepter oubliable, chosifié… ?
Elle avait posé pour lui près de deux ans, par intermittence.
Aujourd’hui, elle ne savait même plus pourquoi elle avait arrêté. Ça finissait toujours comme ça, de toute façon, souvent même plus tôt. L’artiste passait tout simplement à un autre modèle. C’était là le petit marché de la chair humaine. On posait un jour chez l’un, le lendemain chez un autre. (p. 53)

Faune ou dieu Pan, coté senestre de la fontaine Médicis, jardin du Luxembourg, octobre 2017
Du monde de l’art en chantier, le modèle vivant serait à plaindre si tous, professionnels et amateurs, artistes, enseignants et étudiants, ne logeaient à la même enseigne d’un état d’esprit irraisonné dont la sincérité incandescente est vive la liberté mienne !
Le professeur dut faire un effort pour se secouer lui-même, secouer sa rêverie, secouer sa flemme et retrouver son rôle d’enseignant. (p. 126)

La Bocca della verita de Jules Blanchard, jardin du Luxembourg, octobre 2017
Les chutes sont souvent brutales. La lucidité n’exonérant pas des sentiments infiniment cuisants et des tentations suicidaires, les rencontres entre les personnages ressemblent à une épreuve initiatique, révélatrice, quelquefois au sens d’apocalypse…
Clovis tira d’un coup sec le drap qui recouvrait la toile. Dans un mouvement d’horreur, Cécile porta les deux mains à sa bouche avec un cri terrible. Puis elle tâta son cou. On crut qu’elle allait s’évanouir, se mettre à vomir, tomber dans les pommes. (p. 121-122)
L’imaginaire du recueil apparaît sombre, peuplé d’impressions fantastiques, obsessionnelles et, sous les habits de l’évidence, assez bizarrement menaçantes. Comme les demeures dans l’œuvre d’Edgar Poe, les ateliers crasseux, bordéliques reflètent le dedans tourmenté des artistes. Exception faite de la deuxième nouvelle, le narrateur est extérieur au récit qui, dans une langue sobre, aisée, descriptive, orchestre, à l’aide d’effets faussement neutres de procès-verbal, des crescendos efficaces. Partant du banal, les enchaînements suspects, vacillants, conduisent à un point de bascule parfois terrifiant. Le sentiment d’irrémédiable insinue-t-il que la vie est ce théâtre tragique où aucune des parties ne s’en sort indemne ?

Diane à la biche, pierre d’après un antique, jardin du Luxembourg, Paris
Sur la sellette éclaire l’intelligence des actions humaines et des ressorts de l’âme en ce lieu de cauchemar civilisé aux allures sadiennes, fétichistes et chasseresses. La relation entre soi et le monde est un affrontement intense, où le sauvage le dispute au raffiné du chacun pour sa propre jouissance, c’est-à-dire de la liberté entendue comme la poursuite opiniâtre de son intérêt, l’exaltation farouche de sa singularité, des mises en scène pulsionnelle du théâtre de sa tête, un panorama amphibie où l’enfer, c’est les autres sans lesquels, c’est encore l’accès direct à l’enfer…
En appeler un autre, essuyer un autre refus, au dernier moment, elle n’en avait eu ni l’envie ni le courage. C’était comme si soudain elle en avait eu marre. Marre de servir de rafraîchissement à quelques amants qui venaient se distraire, à l’occasion, de leur femme légitime. Seul Marco était célibataire et coureur assumé. Seul Marco l’aurait peut-être intéressée, mais il était en Bretagne, sans doute avec une autre. (p. 137)

L’homme précaire de François Chirpaz, PUF, 2001
Le philosophe français François Chirpaz (1930-2017) écrit : La relation à l’autre est donc, tout à la fois, nécessaire, accentuation de la contradiction de l’exister et exaspération de la violence. Elle commence comme une épreuve et elle est marquée du signe de l’épreuve. (L’homme précaire, PUF, 2001, p. 61)
Les critères d’objectivité et de moralité consensuelle ayant été ensevelis dans la même fosse commune que la notion d’équité, chacun cherche à se faire exister comme il peut au milieu d’une lutte des souverainetés captivant le lecteur autant que l’Art, la seule transcendance, fascine les personnages : il est ce dieu fabuleusement plastique à qui chacun fait dire ce qu’il veut, surtout lorsqu’il est question d’hypothétique chef-d’œuvre inconnu…
Nora ne savait pas de quoi il vivait. Il se vantait d’expositions, de ventes, de gros coups, mais avec lui, on ne savait jamais ce qui appartenait encore à l’art et ce qui relevait déjà de la destruction. (p. 63)

Le marchand de masques, bronze de Zacharie Astruc, jardin du Luxembourg, octobre 2017
Cette mentalité explique peut-être l’entêtement de certains, moins aveugles qu’aveuglés, moins dans le refus du réel qu’une lecture dont le parti pris logique offre un croquis minutieux du piège qui se renferme sur eux : Clovis modèle amateur à son corps défendant, Louima et la gourmandise solitaire d’être bel et bien, Nora et sa confiance démesurée en sa bonne étoile…
Son grand projet. Ce serait son chef-d’œuvre, son apothéose, une sculpture gigantesque de terre et de fer, mélange des matériaux improbable, fragilité de l’une, robustesse et force de l’autre, réconciliation des principes féminin et masculin, une vraie tautologie. Il fallait que ce soit grandiose, transcendantal, fort comme la mort. (p. 62)
Sur la sellette plonge dans un univers avec ses habitudes et ses coutumes (le cornet du modèle), son snobisme masquant ses misères, ses enthousiasmes, ses tendresses, sa peur de vieillir, ses solitudes aussi profondes qu’ailleurs… Même pire, on a envie de dire, tant le désir-monstre a force loi. Les voix intérieures des personnages expriment son emprise, Ie pouvoir absolu qu’il exerce avec la clairvoyance d’une Phèdre dont la raison ne peut tempérer l’incendie qu’en elle, la déesse Vénus a allumé.
Les ateliers de la ville, ce n’était pas un univers si grand que ça. On s’y connaissait tous plus ou moins, et puis Renée était dans la maison depuis trente ans. Trente ans dans le même atelier, quand même c’était un peu la doyenne, ici. Mais Hugues n’avait rien à dire et il ne disait rien. En réalité, on avait fait semblant de savoir. Faute de connaître les circonstances réelles de l’accident, on en avait inventées, des plus romanesques et des plus sinistres. On en avait rajouté. On avait fait travailler l’imagination et grandi les moindres petits faits qu’on avait crus avérés. (p. 25)

Allégorie de la Vérité du monument à Auguste Scheurer-Kestner par Aimé-Jules Dalou, jardin du Luxembourg
Entre le modèle et celui ou celle qui le peint, ça dépend ! Oui, la longue relation de Georges et d’Ida est une collaboration empreinte d’hospitalité, de tolérance et de pudeur.
— Mais enfin, qu’est-ce qui te prend de te mettre toute nue comme ça devant le monde ? Tu es devenue folle ou quoi ? (p. 50)
Ailleurs, Sur la sellette, la collaboration n’est pas exempte d’amitié ou d’amour, mais ces mouvements sont infirmés par la culture de l’incertitude, le goût du provisoire, quand bien même le provisoire dure.
Elle tenait trop l’alcool ou n’aimait pas assez ça pour prendre une vraie cuite et juste oublier le jour de son anniversaire. Deux jours avant, elle avait appelé Marco, un ami peintre avec qui elle couchait occasionnellement depuis quand même huit ans, mais n’avait jamais été foutu de retenir la date de son anniversaire. (p. 137)
Peu importe son ancienneté, la collaboration est une plage privilégiée susceptible de disparaître du jour au lendemain, l’intimité est un équilibre précaire, valable jusqu’à nouvel ordre.
Aymeric tempêtait. Il invectivait son ami avec la mauvaise fois la plus manifeste. Il oubliait que Clovis n’avait jamais demandé le moindre portrait, que c’était son idée à lui seul, son projet, et qu’il l’avait imposé sans même demander son avais à Clovis. (p. 112)

L’Acteur grec, 1868, bronze de Charles-Arthur Bourgeois, jardin du Luxembourg, octobre 2017
N’est-ce pas que toute relation est place, si petite soit-elle, d’un mystère ? À travers le regard de ceux qui gardent la pose, les huit récits du recueil rendent grâce au mystère interdisant de distinguer le prosaïque du sublime, la possession de la dépossession, la sincérité de l’artifice. En fait, de séparer le banal du dramatique du regardé, qui sur la sellette, est le regardant avec ses épaisseurs d’ambivalence sous une peau dont les qualités font le succès, à défaut de la fortune : les modèles vivants sont, comme la plupart des acteurs du spectacle vivant, mal rétribués.
Alors, pourquoi s’obstiner dans un métier physiquement contraignant et mal payé ? Eh bien pour la même raison qu’un écrivain reste vissé à sa chaise ou son bureau des heures durant : il s’agit d’une passion, autrement dit un moyen d’existence.
Loumia continua à poser, souvent jusque quarante heures par semaine, avec passion. Elle continua à aimer ça alla d’un atelier à l’autre, inlassable. Son embonpoint la faisait paraître plus jeune. Elle était tellement grosse qu’elle semblait toujours pleine et fraîche, toujours généreuse et opulente, la peau lisse et ferme d’un enfant. Elle posa ainsi trente-cinq ans. Pendant presque tout ce temps, elle demeura fiable, ponctuelle, inventive. Elle avait l’endurance et la dureté qu’il fallait pour tenir la pose, la créativité qui lui permettait de se renouveler et surtout le plaisir à poser qui se communique à celui qui dessine. Elle aimait son corps, parce qu’il lui obéissait encore, parce qu’il la faisait vivre et payait ses factures. (p. 79-80)

Allégorie du Temps qui porte l’allégorie de a Gloire, monument à Eugène Delacroix par Aimé-Jules Dalou, jardin du Luxembourg, Paris, octobre 2017
Les modèles posent comme les artistes peignent ou sculptent des œuvres qui ne sont donc pas créées à quatre mains, mais à deux corps.
Ils causaient et se réchauffaient de leurs paroles en buvant du thé et s’il y avait de la colère, elle retombait aussitôt. Et ils arrivaient encore à se raconter des choses nouvelles. Georges, parfois, parlait de ses maîtresses. Ida beaucoup moins de ses amants, parce qu’il y en avait beaucoup moins également et donc beaucoup moins à en dire. Leur intimité s’arrêtait là, mais elle était incroyable, parce que chaque jour, du lundi au dimanche sans interruption – on travaillait même double séance le samedi et le dimanche – on posait et on sculptait. (p. 38)

Annie Ferret par Olivier Jouanard, acrylique sur papier, 2015, facebook.com
Cher tout le monde, femmes, hommes et tant d’autres, Annie Ferret est Française, agrégée de lettres modernes, mais pas que… Après avoir été enseignante pendant une dix ans, elle a décidé de se consacrer à l’écriture et au métier de modèle vivant dont elle parle avec passion dans ce trop court reportage télévisé.
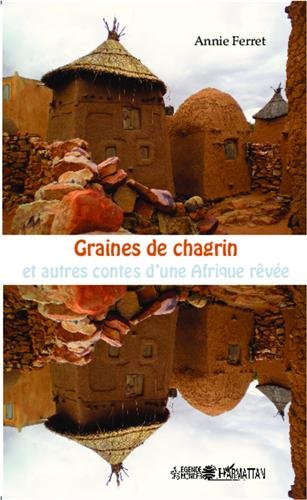
Graine de chagrin et autres contes d’une Afrique rêvée d’Annie Ferret
Africaine d’adoption, Annie Ferret est l’auteure d’un roman Des villes et des hommes, paru, en 2017, aux éditions Proximité. Elle a écrit plusieurs recueils de contes publiés chez L’Harmattan :
Graine de Chagrin et autres contes d’une Afrique rêvée (2013), La sorcière dans la lune et autres contes d’une Afrique rêvée (2014), Les pattes du Chacal et autres contes d’une Afrique rêvée (2015).
On se quitte sans se quitter avec L’éternel retour du duo sans pareil de Brigitte Fontaine et d’Areski Belkacem, tiré de l’album Les églantines sont peut-être formidables sorti en 1980 :
J’en ai passé des nuits à douter du soleil
J’en ai passé des jours à douter des étoiles
J’ai rêvé dans un puits la chute et le soleil
Et l’éternel retour des reflets et des voiles



0 commentaires