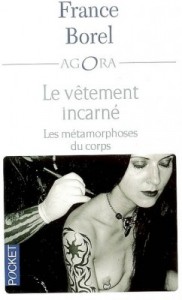 Que disent Les métamorphoses du corps ? (volet 2/2)
Que disent Les métamorphoses du corps ? (volet 2/2)
Cher tout le monde, femmes, hommes et tant d’autres, on dans l’essai Le vêtement incarné, France Borel développe la thèse classique d’un refus universel de la nudité. Son argumentation est naturaliste en ce qu’elle oppose les notions de nature et de culture. Le corps nu serait considéré comme bestial, alors l’homme l’orne et même le sculpte d’une manière souvent indélébile afin de l’arracher à l’ordre animal.

 Question : qu’en est-il des sociétés que l’anthropologue Philippe Descola décrit comme ayant une autre ontologie ?
Question : qu’en est-il des sociétés que l’anthropologue Philippe Descola décrit comme ayant une autre ontologie ?
 Les sociétés animistes et totémistes dont la cosmologie et la vision du monde n’entendent pas la structure d’opposition nature et culture ?
Les sociétés animistes et totémistes dont la cosmologie et la vision du monde n’entendent pas la structure d’opposition nature et culture ?
 Elles aussi se livrent à une appropriation du corps à travers des processus de transformation : tatouages, scarifications, maquillages, artifices, parures de plumes, matériels de contention, bijoux, mutilations, modelages précoces du crâne ou des membres, limages des dents…
Elles aussi se livrent à une appropriation du corps à travers des processus de transformation : tatouages, scarifications, maquillages, artifices, parures de plumes, matériels de contention, bijoux, mutilations, modelages précoces du crâne ou des membres, limages des dents…

 Est un fait universel que : Sous aucun tropique ne persiste la nudité intégrale offerte par la naissance. L’homme met son empreinte sur l’homme. Le corps n’est pas un produit de la nature, mais de la culture. Le passage du corps brut au corps social est souvent un rite qu’accompagne la douleur (p. 32). Le proverbe dit : il faut souffrir pour être beau.
Est un fait universel que : Sous aucun tropique ne persiste la nudité intégrale offerte par la naissance. L’homme met son empreinte sur l’homme. Le corps n’est pas un produit de la nature, mais de la culture. Le passage du corps brut au corps social est souvent un rite qu’accompagne la douleur (p. 32). Le proverbe dit : il faut souffrir pour être beau.
 L’appropriation du corps suppose de celui-ci soit docile, voire ductile. C’est-à-dire fort du courage de se plier aux métamorphoses douloureuses.
L’appropriation du corps suppose de celui-ci soit docile, voire ductile. C’est-à-dire fort du courage de se plier aux métamorphoses douloureuses.
 Partout, le corps ne peut interagir avec ses semblables que s’il est signifiant, lisible, plus ou moins, déterminé selon des modèles, un idéal. Les modifications codifiées finissent par faire partie intégrante de lui, elles s’incorporent et définissent l’image de soi.
Partout, le corps ne peut interagir avec ses semblables que s’il est signifiant, lisible, plus ou moins, déterminé selon des modèles, un idéal. Les modifications codifiées finissent par faire partie intégrante de lui, elles s’incorporent et définissent l’image de soi.
 Ces transformations s’offrent non seulement à nos propres yeux, mais aux yeux des autres. (p. 34)
Ces transformations s’offrent non seulement à nos propres yeux, mais aux yeux des autres. (p. 34)
L’organisation des apparences codifie le convenu et l’inconvenant, le désirable et le repoussant, distingue l’espace de la pudeur et de l’exhibition, sans que la frontière soit toujours nettement tracée.
 Le corps est autant social qu’intime, sa manipulation symbolique permet d’affirmer et de traduire l’identité, la dignité, la trajectoire de l’un par rapport à l’autre et aux autres, la personnalité, le courage, la créativité…
Le corps est autant social qu’intime, sa manipulation symbolique permet d’affirmer et de traduire l’identité, la dignité, la trajectoire de l’un par rapport à l’autre et aux autres, la personnalité, le courage, la créativité…
 Le corps est l’espace du désir par excellence. Son ornementation n’est pas rationnelle. L’affirmation des signes du pouvoir, le besoin de séduction et la préférence esthétique l’emportent sur les autres mobiles.
Le corps est l’espace du désir par excellence. Son ornementation n’est pas rationnelle. L’affirmation des signes du pouvoir, le besoin de séduction et la préférence esthétique l’emportent sur les autres mobiles.
 La peau est une surface rêvée qui capture le regard et concentre le fantasme.
La peau est une surface rêvée qui capture le regard et concentre le fantasme.

La séduction dévoile la réalité, comme cela, pour le plaisir, dans la gratuité de l’artifice ; elle est insensée (p. 63). Plaire est une soif que chaque culture exprime à sa façon. Mutilations et port de parures vont presque toujours à l’encontre d’un usage fonctionnel du corps. Page 71, l’auteure cite Marcel Griaule, Dieu d’eau :
Être nu, c’est être sans parole.

Dans le chapitre III, Écrire à fleur de peau, il est question des tatouages. Le mot tatouage vient du tahitien tatau, « dessin », dérivé de tatatu, « blesser » (p. 148).
 Le capitaine Cook note le terme en transcrivant tattow ou tattoo. Dans son journal, il décrit les différentes étapes du processus de perforation de la peau afin d’y faire pénétrer une substance tinctoriale (p. 149).
Le capitaine Cook note le terme en transcrivant tattow ou tattoo. Dans son journal, il décrit les différentes étapes du processus de perforation de la peau afin d’y faire pénétrer une substance tinctoriale (p. 149).
En Polynésie et dans les cultures océaniennes où le tatouage indique le rang social, des mythes entourent la pratique du tatouage. Les Européens, marins, soldats, explorateurs, scientifiques, nobles ont ramené de leur voyage des tatouages et des récits fascinants sur la beauté des dessins et l’épreuve de résistance qu’endure le tatoué.  Dans une chrétienté qui condamne les dessins et inscriptions corporelles, seuls les aventuriers, les voyous, les artistes osaient le tatouage : leur peau apparaissait alors comme un journal de bord ou un carnet de route. La mémoire en image de leurs odyssées et découvertes de territoires inconnus de leurs concitoyens.
Dans une chrétienté qui condamne les dessins et inscriptions corporelles, seuls les aventuriers, les voyous, les artistes osaient le tatouage : leur peau apparaissait alors comme un journal de bord ou un carnet de route. La mémoire en image de leurs odyssées et découvertes de territoires inconnus de leurs concitoyens.  Aux yeux de la bourgeoisie bien-pensante, le tatouage fait très mauvais genre. Cesare Lombroso, le criminaliste italien, prétend qu’il serait le premier pas vers le crime et la prostitution (p. 164). Il est vrai que, dans le milieu carcéral, le pourcentage de tatoués est élevé. D’un autre côté dans une société ultra normative, la frontière de la délinquance est vite atteinte. Les aristocrates s’en tapent ou trouvent cette réprobation stimulante !
Aux yeux de la bourgeoisie bien-pensante, le tatouage fait très mauvais genre. Cesare Lombroso, le criminaliste italien, prétend qu’il serait le premier pas vers le crime et la prostitution (p. 164). Il est vrai que, dans le milieu carcéral, le pourcentage de tatoués est élevé. D’un autre côté dans une société ultra normative, la frontière de la délinquance est vite atteinte. Les aristocrates s’en tapent ou trouvent cette réprobation stimulante !  À la fin du dix-neuvième siècle et au début du vingtième, dans la High society, femmes et hommes estiment élégant d’être tatoués. Selon les goûts, l’inspiration est océanienne, japonaise, orientale.
À la fin du dix-neuvième siècle et au début du vingtième, dans la High society, femmes et hommes estiment élégant d’être tatoués. Selon les goûts, l’inspiration est océanienne, japonaise, orientale.

La pratique fait aussi la fortune des directeurs de cirque, de fêtes foraines, de zoos humains, qui produisent des phénomènes spectaculaires, exotiques pour de vrai ou de faux, et dont le sort est souvent malheureux. Le tatouage peut aussi fonctionner comme signe d’appartenance à une confrérie, un club, une organisation sectaire, une loge, un corps d’armée. Il peut avoir un sens politique ou magique (p. 173). Dans les sociétés, tout au long du vingtième siècle, les femmes se tatouent, mais de façon discrète et à tout âge.
Voyage savant et parfois drôle dans l’immensité des conduites métamorphiques aux quatre coins du corps et du monde, le bel essai de France Borel, Le vêtement incarné, a été réédité, en 2006, aux éditions Pocket, mais les références ci-dessus se rapportent à l’édition originale parue chez Calmann-Lévy en 1992.
Tattoo, une chanson dans laquelle The Who évoque les rites de passage du tatouage témoignant de l’inquiétude des hommes au sujet de la virilité :
Me and my brother were talking to each other
Mon frère et moi on s’est parlé
‘Bout what makes a man a man
à propos de qu’est ce qui fait d’un homme un homme
Was it brain or brawn, or the month you were born,
Est-ce que c’est le cerveau ou les muscles, ou le mois où tu es né,
We just couldn’t understand
On ne pouvait pas comprendre
Mes remerciements à Mila Trachic dont l’art accompagne l’article. Retrouvez ses tatouages sur son website.
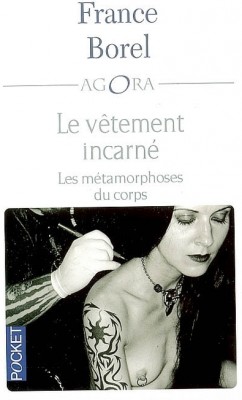



0 commentaires
Trackbacks/Pingbacks