La poétique relationnelle et les lucioles-veilleuses de vie solidaire

Patrick Chamoiseau, Journée Mondialité, Fondation Boghossian-Villa Empain, Bruxelles, samedi 9 septembre 2017
Cher tout le monde, femmes, hommes et tant d’autres, avec Frères migrants, l’écrivain martiniquais Patrick Chamoiseau exhorte à accueillir l’humain, sa vie et sa vision de la vie en ces femmes, hommes, enfants (ou petites personnes, timoun en créole) :
[…] toutes les qualités de personne qui dépérissent et périssent (p. 21).
 Dans l’immense appel du penseur de la créolité, il y a les accents précatifs de François Villon, le poète dont, à trente et un ans, on perd la trace. Disparu au sens littéral, le délinquant multirécidiviste invoquant moins la pitié des vivants pour le gibier de potence que la miséricorde envers les pauvres dans ce qu’on devrait nommer la Ballade des perdus.
Dans l’immense appel du penseur de la créolité, il y a les accents précatifs de François Villon, le poète dont, à trente et un ans, on perd la trace. Disparu au sens littéral, le délinquant multirécidiviste invoquant moins la pitié des vivants pour le gibier de potence que la miséricorde envers les pauvres dans ce qu’on devrait nommer la Ballade des perdus.
Les perdus contemporains sont les milliers de migrants, noyés en Méditerranée – la mer au milieu des terres, et qui périssent en bordure des nations, des villes et des États de droit… (p. 21)

Hans Ulrich Obrist et Asad Raza (commissaires d’exposition), Patrick Chamoiseau, Journée Mondialité, Fondation Boghossian-Villa Empain, Bruxelles, 9/09/2017
Patrick Chamoiseau, prix Goncourt 1992 pour Texaco, dit : Il faut agir, une cause est là !… (p. 16)
La mare nostrum peut-elle encore être appelée notre mer ?
Le berceau de leur civilisation est devenu une tombe (p. 41).

Le corps sans vie du petit Alan Kurdi photographié par Nilüfer Demir, wokipedia.org
La catastrophe d’un point de vue humanitaire est une catastrophe politique : « l’abandon de tout un océan aux vocations de cimetières » (p. 41). Le politique est sans réponses face au corps sans vie, sur une plage turque, du petit Aylan, le garçonnet kurde dont la photo a ému l’opinion.
L’impuissance politique a transformé l’espace vivant de circulation, entre l’Afrique, l’Asie et l’Europe en frontière liquide cimetière. Un lieu de condamnation miroir de l’incommensurable océanique du Gouffre (p. 21), trois fois noué à l’inconnu, d’Édouard Glissant qui est la faute originelle de l’impérialisme occidental :
Le continent des Africains du fond de l’Atlantique – continent sans adresse, où les cales du bateau négrier ont pu broyer durant des siècles les fondements de l’Afrique, les fils aînés du genre humain – rejoint dans une exacte sidération son double en Méditerranée. (p. 23-24)
Dans l’horreur du Gouffre de La mort invisible, (p. 21 et suivantes), l’écriture de Frères migrants, qui est hommage aux victimes trop anonymisées de Lampedusa, de Malte, des bordures grecques et italiennes, etc., évoque tantôt le macabre villonien, tantôt les métamorphoses ovidiennes. Elle est critique du déshabiter de la relation en nous, d’une désaffection ignorante d’elle-même, car en refoulant les gens qui envisagent leur vie insuffisante et en désirent d’autres, autant qu’il en faut à l’imaginaire du chemin à parcourir, nous refoulons un ressort profond : le besoin de faire société inséparable de l’élan de l’hospitalité. Les migrants sont accablés par la découverte de notre misère consentie : combien, dans les nations dites démocratiques, mais assujetties à la logique néolibérale, peuvent être illusoires les droits arrachés de haute lutte par le peuple et les « forces de la décence » (p. 35) :
À Paris, à Vintimille, et comme depuis près de quinze ans dans la région de Calais, des migrants restent échoués en marche de toutes les marges […] (p. 14)
Ils sont hors-la-loi dans des pays qui ont signé la Déclaration universelle des droits de l’homme, dont l’article 13 stipule :
1) Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État.
2) Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
Migration est emprunté au latin migratio : passage d’un lieu à un autre. Mais, loin de la racine de la langue, nous nous accommodons d’une catégorie, non de nomades – ils n’ont pas de culture du nomadisme, mais de bannis qui, coupables d’avoir voulu progresser, n’arriveront pas à destination :
[…] alors que bien des pays pauvres recueillent tant bien que mal des migrations massives, les États-nations d’Europe préfèrent dire à la vie qu’elle ne saurait passer. Eux qui ont tant migré, tant brisé de frontières, tant conquis, dominé, et qui dominent encore… (p. 41)

Patrick Chamoiseau, Journée Mondialité, Fondation Boghossian-Villa Empain, Bruxelles, samedi 9 septembre 2017
Patrick Chamoiseau écrit : « voici ce qu’il te faut considérer : ils refoulent les migrants parce que les migrants ne leur laissent pas le monde. » (p. 56)
Qu’elle soit colère ou compatissante, analytique ou affective, dans ce texte sensible et lettré, la plume est partout politique, tresse d’un désir éthique et esthétique ardemment lyrique, voire prophétique placé sous le signe de l’ivre de l’être et des poécepts d’Édouard Glissant, dont le septième chapitre : La mondialité, le plus long du livre, fait éprouver l’extraordinaire ordinaire.
Cette indéfinissable mise en relation avec le tout-vivant du monde nous émeut, nous affecte, comme auraient dit les philosophes. Elle nous transforme lentement, sans but ni intention. Nous offre à éprouver de plus humaines intensités. Nous animent d’autre chose que des lois du profit et de ses exclusions. Nous remplit en finale d’une éthique sans grande démonstration, juste soucieuse de beauté. Beauté de l’immobile. Beauté du rien. Beauté de l’inutile et du gratuit. Beauté du geste. Beauté de l’attitude. Beauté de la pensée. Beauté de chaque désir et de ses aspirations… (p. 55)
Cette latitude de raffinement ultra-terrestre, nous en réprimons le pressentiment peut-être à cause du prestige de l’intelligence accordé plus volontiers à la méchanceté qu’à la bonté ? au dédain qu’au respect mutuel ?

Patrick Chamoiseau, Fondation Boghossian-Villa Empain, Bruxelles, 9 septembre 2017
Des murs sont dans nos têtes et nous imposent leurs horizons.
Ils nous rendent aveugles à plein de perspectives. (p. 166)
Peut-être est-ce faute de penser l’interdépendance ontologique ? D’adhérer à la croyance que l’homme est un loup pour l’homme, et la nature humaine mauvaise, cupide, prompte à verser dans les cruautés anarchiques sans le gouvernement d’une ou des autorités ? Pourtant, ce contre quoi s’élève aussi le poète haïtien James Noël dans La migration des murs : la prolifération des murs ne provient-elle pas plutôt des excès d’ordre établi ? Les murs sont la crête des lois sanguinaires de ne pouvoir rien contre l’immémorial recommencement des déplacements, rien contre le fait que la migration est humaine :
Aucune clôture ne saurait contester le réel, ni invalider le passage du vent, l’envolée des oiseaux… (p. 110)

Hans Ulrich Obrist, Asad Raza, Patrick Chamoiseau, Journée Mondialité, Fondation Boghossian, 9/09/2017
La migration est une soif intime de l’aventure du monde : l’appel secret de ce qui existe autrement (p. 67). Il faut lui ouvrir la porte en une qualité de don dont la cordialité casa nostra, casa vostra des gestes est ce que précisément nous interdit l’économie de prédation. Patrick Chamoiseau se fait le chantre d’une poétique de la mondialité dont la mondialisation homicide et écocide est le négatif avec sa razzia des biens communs (p. 36) accélératrice de conflits, exclusions, souffrances, solitudes humaines et destructions du vaste vivier de créatures co-humaines et de présences non humaines :
Il y a tant d’êtres humains qui ne respectent pas les arbres ou qui n’ont pas de frères parmi les végétaux. Tant d’autres qui n’ont aucun souci des enfers anthropiques où disparaissent les animaux, où s’étiole la biodiversité planétaire. (p. 87)

Patrick Chamoiseau, Journée Mondialité, Fondation Boghossian-Villa Empain, Bruxelles, 9 septembre 2017
Cette nuit politique, au sens pasolinien (p. 20), est-elle la fin de notre espèce ? Où est la sortie ? Où est l’aube salvatrice ? L’aube est déjà là. Elle a toujours été là. Elle est du côté de la conscience de l’envergure réelle de l’homme irriguant l’échange de paroles entre l’écrivain et Hind, celle qui filme et Jane, celle qui écrit et murmure :
À Paris, je sers du café chaud et des tranches de paix beurrés, à des yeux dépourvus de paupières. Ces pupilles, blanchies de vigilances et du sel des déserts, sont comme des sémaphores. (p. 13)
L’aube est du côté des apparitions multiples de l’inattendument debout d’Aimé Césaire :
Pourtant […] l’imprévisible surgit. Quelques êtres humains – je parle de gens de l’ordinaire, sans titre et sans blason – s’éveillent malgré tout à quelque chose en eux. (p. 42)

Patrick Chamoiseau, Journée Mondialité, Fondation Boghossian-Villa Empain, Bruxelles, 9 septembre 2017
L’aube est du côté des voltiges des lucioles : ces voix et ces mains ouvertes à l’action qui résiste, qui outrepasse… (p. 53). Les écarts lumineux qu’elles produisent paraîtraient de l’allant de soi si elles n’étaient hors-la-loi :
Des compatissants sont déférés devant les tribunaux au moyen d’un délit de solidarité ! (p. 15)
Est passible de poursuites judiciaires la dissidence incarnée dans l’accueil qui ici n’est pas seulement un don. Il est une des modalités du juste-vivre au monde (p. 89). Donc, où le diktat de l’argent-roi criminalise l’intime et la bienveillance, fait d’eux une région de faute, il désigne aussi le lieu de la résistance radieuse contre le déni d’humanité de nos vies présentes et passées, contre le déni des déplacements et des déportations de nos ascendants et, en définitive, comme « Homo sapiens est aussi et surtout Homo migrator » (p. 44), contre le déni de l’aube préhistorique et de l’odyssée prodigieuse de notre espèce comme déploiement de persévérance en chair et en os et en inventivité. Au nom de quoi ? D’un totalitarisme dévastateur pour le maillage du vivant :
Là où leur « Marché » devrait distinguer le meilleur, préserver l’intérêt du commun, il assure en fait le plus grand des profits, mais pas pour tous, pour quelques-uns pas très nombreux. Profit plus facile, total, indécent, coupé de la réalité sociale, étranger à l’éthique, et sans limites connues. (p. 82)

Hans Ulrich Obrist, Asad Raza, Patrick Chamoiseau, Journée Mondialité, Fondation Boghossian-Villa Empain, 9/09/2017
Le culte tentaculaire du lucre constrictor réduit tout partout la terre : il n’y a plus d’ici ni de là-bas (p. 45), seulement une unité tragique (p. 47), ciment des replis identitaires interdisant d’envisager l’unité essentielle : la coexistence ou la positivité de la vulnérabilité consubstantielle à la condition humaine, non close ou finie, mais ouverte au monde, de sorte que rien, à vrai dire, rien n’anime le quotidien comme le souci du devenir de l’autre où on devient :
C’est la mondialité qui incline notre idée de l’humain vers l’horizontale plénitude de ce qui vit sur terre. (p. 54)
Après avoir, longuement, théorisé l’infériorité par nature des Autres, c’est-à-dire de la multiplicité hétérogène de l’être concret, l’idéologie de la cupidité débridée, campée sur son progressisme bancal et normalisateur, raconte la nouvelle savantise de l’incapacité culturelle dont la différence, encore et encore définie a priori, serait rédhibitoire. Pour cette peur du réel, le migrant est une absence qui ne manque pas. Sa rencontre n’est pas auréolée de mystère, magie de l’inconnu et de la découverte, elle est linceul de la perte et promesse de corruption d’un équilibre sociétal présumé modèle. Sauf que la rhétorique de l’hostilité préfabriquée ne masque plus l’effondrement structurel :
Au cœur des richesses urbaines apparaissent les décrochages sociaux. Les précarités y deviennent structurelles avec ou sans emploi. (p. 31)
Au fil de son triomphe, cette barbarie perd son invisibilité (p. 29). Se voit ce qu’elle a toujours fait : du diviser pour régner, du niveler par le bas des activités humaines dégénérées en misères mentales et matérielles. Se voit ce qu’elle a toujours été : l’indigence glacée de la rentabilité souhaitant la nature et les travailleurs standardisés, aussi interchangeables et jetables que les produits mal confectionnés que l’obsolescence programmée oblige à racheter.

Hans Ulrich Obrist, Asad Raza, Patrick Chamoiseau, Journée Mondialité, Fondation Boghossian, 9/09/2017
La paix du libre-échange veut :
qu’une vie – nos existences entières ! – puisse se retrouver confite sous la fascine du Caddie débordant et du « pouvoir d’achat » (p. 26).
C’est ainsi que nous nous fions davantage au dogme de la concurrence déloyale plutôt qu’à notre expérience d’être « en lien » de façon constitutive, puisque, oui, seul, l’humain s’affaisse sous le poids du sentiment d’inexister. Alors, n’est-ce pas parce qu’en chacun, les zones les plus disponibles pour le génie de la nuance qui bricole sa mélodie au plus près du chaos ou de l’inaperçu, n’est-ce pas parce qu’en chacun, les parts les plus uniques, singulières, joyeuses, étranges, précieuses sont inséparables de l’autre, qu’on éprouve un malaise à entendre : nous n’avons pas le choix ? L’impossibilité d’accueil martelée par le réalisme autoproclamé des élites politiques et économiques, et relayée par les médias dominants, est l’inverse du pragmatisme qui, lui, consiste à prêter attention à l’évidence :
Quand l’Humain n’est plus identifiable par l’humain, la barbarie est là. (p. 43)
Cette idéologie sorcière est un chant des sirènes qui médiocrise l’imaginaire et dissout toute forme d’impulsion autre que celle de la lutte mortifère pour la survie et l’obsession casino de la place au soleil de la prison morbide du chacun pour soi d’abord et toujours :
Le Tout-profit est cette liberté systémique qui ne fait qu’asservir (p. 83).
Ce pseudo-féodalisme de l’avidité et son hybris suicidaire capturent d’autant plus qu’on peine à admettre sa férocité moins accidentelle, qu’intrinsèque. Le système capitaliste prend son essor dans le colonialisme, donc, le débridement d’une violence brutale ou sournoise, selon les lieux et les époques, que subissent et perfectionnent, de gré ou de force, les êtres à chaque échelon d’une hiérarchie briseuse d’alternatives, d’espaces, de désirs, même et a fortiori lucides. Comme le souligne Robert Antelme : Il n’y a pas de différence de nature entre le régime « normal » d’exploitation de l’homme et celui des camps. Le camp est simplement l’image nette de l’enfer plus ou moins voilé dans lequel vivent encore tant de peuples.
Aux figements dissolvants, à la paix acide, il s’agit d’opposer la poétique du bon et du beau :
Cette part de notre imaginaire qui dans l’instinct dénoue et ouvre à fond, qui dans l’instinct se relie à d’autres imaginaires, qui rallie qui relaie et relate les sensibilités, la joie, la danse, la musique, l’amitié, la rencontre, et qui surgit des magnétismes de ces rencontres multi-trans-culturelles, orchestrées, par le hasard, les accidents, la chance et les errances… (p. 54)

Hans Ulrich Obrist, Asad Raza, Patrick Chamoiseau, Journée Mondialité, Fondation Boghossian-Villa Empain, 9/09/2017
La mondialité et l’écosystème de la Relation sont l’impensé de la mondialisation qui ne sait qu’instrumentaliser les dualismes centre-périphérie, maître-esclave, colon-colonisé, élu-indigne coinçant la pensée dans des choix successifs dont parle Gilles Deleuze à Claire Parnet dans Dialogues, p. 27-28 :
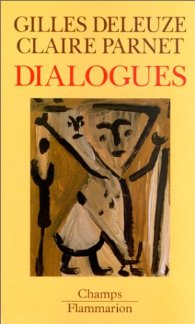 […] tu es un blanc ou un noir, un homme ou une femme, un riche ou un pauvre, et. ? Tu prends la moitié droite ou la moitié gauche ? Il y a toujours une machine binaire qui préside à la distribution des rôles, et qui fait que toutes les réponses doivent passer par des questions préformées, puisque les questions sont déjà calculées sur les réponses supposées probables d’après les significations dominantes. Ainsi se constitue une grille telle que tout ce qui ne passe pas par la grille ne peut matériellement être entendu.
[…] tu es un blanc ou un noir, un homme ou une femme, un riche ou un pauvre, et. ? Tu prends la moitié droite ou la moitié gauche ? Il y a toujours une machine binaire qui préside à la distribution des rôles, et qui fait que toutes les réponses doivent passer par des questions préformées, puisque les questions sont déjà calculées sur les réponses supposées probables d’après les significations dominantes. Ainsi se constitue une grille telle que tout ce qui ne passe pas par la grille ne peut matériellement être entendu.
Ne passe pas par la grille la migrance ! Toute migrance ! Toute fugue multiforme ! Improvisation d’entrelacs ! Tangence dialogique ! Profuse présence au monde ! Fécondité paradoxale ! Échappée ambulante et extatique ! Tremblante et aventureuse lecture des impressions feuille à feuille, des sensations pas à pas, des inspirations piste à piste ! Tout trouble insensément sensé auquel répond l’élan de la compassion qui fait accueil.
Qu’elle doit consciente ou pas, la Relation déterritorialise. (p. 91)
Affleurant à la poésie, l’ode-réflexion de Frères migrants célèbre une production de sens polyphonique qui n’est pas sans rappeler :
 « On n’est pas dans le monde, on devient avec le monde, on devient en le contemplant. Tout est vision, devenir. On devient univers. Devenirs animal, végétal, moléculaire, devenir zéro ». (Gilles Deleuze et Félix Guattari, Qu’est-ce que la philosophie ?, éditions de Minuit, p. 160)
« On n’est pas dans le monde, on devient avec le monde, on devient en le contemplant. Tout est vision, devenir. On devient univers. Devenirs animal, végétal, moléculaire, devenir zéro ». (Gilles Deleuze et Félix Guattari, Qu’est-ce que la philosophie ?, éditions de Minuit, p. 160)

Hans Ulrich Obrist, Asad Raza, Patrick Chamoiseau, Journée Mondialité, Fondation Boghossian, Bruxelles, 9/09/2017
En Relation, personne ne saurait ni ne pourrait décevoir personne. (p. 89)
L’accueil n’emprisonne pas l’autre dans son rêve, précise Patrick Chamoiseau en faisant allusion à la mise en garde de Deleuze, lors de la conférence Qu’est-ce que l’acte de création ? donnée, le 17 mai 1987, dans le cadre des Mardis de la Fondation Fémis : le rêve de ceux qui rêvent concerne ceux qui ne rêvent pas […]. Méfiez-vous du rêve de l’autre, parce que si vous êtes pris dans le rêve de l’autre, vous êtes foutus.
L’élan de la bienveillance est humble de sourdre de la mondialité, du poétiquement humain rebelle, affecté et affectant, tendu vers le dynamisme de la liberté d’être nœuds multiples, mus par l’entrain, nourri de peurs et de doutes, portant les uns vers les autres, autres hommes et autres horizons dans l’étonnement du dicible et de l’audace de l’indicible, le frisson d’une espérance nomade, les conversations créoles de l’itinérance imprécise – sans frontière, ni dedans ni dehors – où la conscience partagée est élancement vers la con-naissance de ce dont nul ne vient à bout.

Hans Ulrich Obrist, Asad Raza, Patrick Chamoiseau, Journée Mondialité, Fondation Boghossian, 9/09/2017
Les totalitarismes haïssent ce mouvement, vieux comme l’humain en son désir de l’impensable et des possibles excédents, sa jubilation, aussi obscure que la nuit des temps, à cheminer dans les régimes de l’ailleurs d’être et l’appel de l’impréparé plus emportant que le quant-à-soi. Les totalitarismes redoutent cette joie de la vie et de l’ouvert dans sa consistance de fait et de fougue arcboutée sur le mystère qui, en chacun, est maître d’œuvre de l’imprévisible et de l’insaisissable, des solidarités et des dissidences du vivre-ensemble dont les (ré)créations élargies, les réécritures de tous par tous sont, dans Frères migrants, une précipitation d’abondances artistes dignes des figures nietzschéennes du danseur et du poète.
Ce n’est pas dans la contraction du « moi-je » que la personne découvre son unité, mais dans l’alliance fluctuante de ses multiplicités internes. (p. 96)

Hans Ulrich Obrist, Asad Raza, Patrick Chamoiseau, Journée Mondialité, Fondation Boghossian, 9/09/2017
En créole haïtien, le proverbe dit : tout koukouy klere pou je l, les bêtes-à-feu n’éclairent que pour leur propre corps. Aimé Césaire, usant de l’image des lucioles qui virevoltent dans la nuit autour des paysans, souligne à quel point ces petites lueurs vivantes étaient plus précieuses que les grands projecteurs ou les aubes salvatrices (p. 125). Parce que la résistance en sa chair palpitante est toujours modeste, clandestine, souterraine, dans le dernier chapitre du livre : la Déclaration des poètes (voir ici), lancée le 1er février 2017, on lit :
[…] le vouloir commun contre les forces brutes se nourrira d’infimes impulsions.
Cher tout le monde, femmes, hommes et tant d’autres, Frères migrants est paru en mai 2017 aux Éditions du Seuil. Imaginons le courage qu’il inspire dôme de douceur de la somptuosité de Quatro Cantos d’Egberto Gismonti, le compositeur, guitariste, pianiste, flûtiste brésilien, inclassable d’un jazz des traversées de l’esprit empruntant aux cultures atlantiques, aux mondes vivants, aux esprits des éléments et des espaces naturels de la terre une dont nous, humains, ne sommes qu’une espèce de créatures parmi d’autres, qu’une espèce d’intelligence, de mémoire, de sapience, de poésie vagabonde…



0 commentaires