
L’académicien Dany Laferrière tenant une photo de James Baldwin, Week-end Hommage à James Baldwin, auditorium Jean Rouch, musée de l’Homme de Paris, 9 décembre 2017
Haïti ou l’île-joie de l’esprit littéraire et autres réflexions sur la parole débordante
Cher tout le monde, femmes, hommes et tant d’autres, l’écrivain, scénariste et membre de l’Académie française Dany Laferrière était le parrain du Week-end Hommage à James Baldwin qui s’est déroulé au musée de l’Homme de Paris, les 9 et 10 décembre 2017.

Dany Laferrière, Samuel Légitimus, Week-end d’hommage à James Baldwin, auditorium Jean Rouch, musée de l’Homme de Paris, 9 décembre 2017
Après cette manifestation, l’homme de plume, qui se partage entre Haïti, le Québec, la France et bien d’autres lieux réels et imaginaires, donc, l’homme du monde immense, a eu l’amabilité d’accorder cet entretien.

Dany Laferrière, Samuel Légitimus, fondateur du Collectif James Baldwin, Karen Thorsen, réalisatrice de The Price Of The Ticket, dans l’auditorium Jean Rouch, Week-end Hommage à James Baldwin, 9 décembre 2017
Les vagabonds sans trêves : Je suis surprise d’entendre parler du miracle littéraire haïtien. À ma connaissance, il y a deux cents ans de littérature en Haïti et je tombe des nues quand on parle ainsi, comme si une source avait jailli miraculeusement ?
Dany Laferrière : C’est parce que les gens mettent ça dans le contexte des conditions économiques misérables d’Haïti et de la situation politique survoltée. Puis beaucoup viennent de découvrir Haïti avec le tremblement de terre de 2010. Ensuite, ils ont leur idée de l’île. Une île, pour eux, c’est un paysage verdoyant où les gens vont cueillir des fruits mûrs sur les arbres avant d’aller s’asseoir près de la mer pour causer longtemps. Leur dire que c’est un pays avec ses drames, ses passions et parfois ses bonheurs, ils ont une certaine difficulté à intégrer ça. En fait, il leur est difficile de comprendre une notion de pays qui ne soit pas basée sur le consumérisme. Tout cela leur semble tenir par un effet magique.

Samuel Légitimus, Dany Laferrière et Chrystel Bonfils Doziass, devant l’auditorium Jean Rouch, Week-end Hommage à James Baldwin, musée de l’Homme, 9 décembre 2017
La magie… ? Mais Haïti, c’est deux cents ans de littérature !
Si deux cents ans c’est beaucoup pour nous, ce n’est pas tant à l’échelle européenne. Et c’est un si constant effort pour survivre qu’ils pensent qu’on n’a pas encore atteint le stade culturel. Beaucoup croient que, sur les deux cents ans, la réalité ne nous a pas laissé le temps de réfléchir. De plus, un livre n’existe que quand il apparaît dans les librairies européennes ou américaines. Mais la force d’Haïti, c’est qu’elle est autonome. Paradoxalement, c’est un pays qui peut fonctionner presque tout seul, parce que, précisément, pendant deux cents ans, on l’a poussé à une certaine autarcie. Et Haïti s’est mise à faire de la littérature sans penser que c’est aussi un marché. Pendant longtemps, les livres étaient plus volontiers donnés que vendus. Pourtant, les écrivains étaient plus souvent pauvres et persécutés par des régimes obscurantistes. Malgré l’absence d’une critique littéraire sérieuse, on parvenait à produire une littérature de qualité.

Dany Laferrière lors de la rencontre-lecture d’Ayiti la !, Les lettres haïtiennes en mouvement, Jardin botanique, Bruxelles, 8 juin 2017
Est-ce la même chose pour les autres arts ?
Bien sûr, la peinture, comme la musique. Notre musique a fonctionné pendant longtemps sans critique, à part celle du public… Cela a pris un temps avant qu’on trouve une logique de vente. Les disques ne sortaient pas en prévision des achats de Noël. On les sortait quand ils étaient prêts et le public se ruait alors au quartier général du groupe ou chez les disquaires. Livre, peinture, musique, tout ça n’était pas présenté dans une perspective commerciale. Un vent de fraîcheur soufflait sur le milieu culturel d’alors. Les émissions de radio n’étaient pas fondues pour une tranche d’âge particulière. C’était un fourre-tout. On passait ce qu’on voulait. De temps en temps, on entendait la publicité. Il n’y avait pas ce complot marchand qui poussait à acheter.

Dominique Gillerot (CEC-ong) médiatrice de la rencontre-lecture « Littérature et mondialité » avec Rodney Saint-Éloi, James Noël, Felwine Sarr, Emmelie Prophète, Dany Laferrière, Néhémy Pierre-Dahomey, Ayiti la !, Les lettres haïtiennes en mouvement, Jardin botanique, Bruxelles, 8 juin 2017
Où il n’y a pas cette contrainte, qu’est-ce qui prime ?
La dimension sociale. Voilà ce qui, en Haïti, est miraculeux et ça n’a rien à voir avec le miracle de la littérature. Il n’y a pas de miracle en écriture. Les livres doivent être écrits et cela exige un effort constant. Et on ne peut pas faire une littérature tout seul dans son coin. Il faut une lignée. Nos prédécesseurs nous montrent la route même si on n’est pas obligé de prendre le même chemin que le leur. Par prédécesseurs, je n’entends pas uniquement des Haïtiens, la bibliothèque est vaste. Mais si on n’a pas un lectorat qui achète, on a un lectorat qui lit et surtout qui relit.
Concrètement, ça se passe comment ?
On n’a presque pas d’éditeurs, en sachant qu’un éditeur prend toutes les dépenses de la fabrication du livre à son compte. Je connais beaucoup de poètes qui écrivent des recueils de poèmes qu’ils éditent en vendant un morceau de terrain ou en retirant de la banque l’argent qu’ils ont épargné pour payer l’imprimeur. Dès lors, c’est toujours à perte qu’on édite un livre. Un livre qu’on ne vendra pas toujours. C’est déjà beaucoup si on parvient à vendre cent exemplaires en librairie. L’idée de vendre un livre, non ! Tout ce qui nous reste, c’est la littérature elle-même. Et ça, c’est le vrai miracle, avoir pu faire une littérature qui est lue par des lecteurs avertis et affamés. D’ailleurs, on écrit beaucoup sur la littérature, mais pas assez sur l’écriture. Beaucoup d’articles dans les journaux sur la littérature, mais de critique qui soit indépendant, qui tente d’une manière ou d’une autre de dire ce qu’il pense, on n’en a pas tellement. Mais on a la littérature et ce goût de l’alphabet fait comprendre que tout le reste n’est que secondaire dans ce pays.

Dany Laferrière lors de la rencontre-lecture d’Ayiti la !, Les lettres haïtiennes en mouvement, Jardin botanique, Bruxelles, 8 juin 2017
Qu’en est-il de ce qui se pratique ailleurs, par exemple en Europe ?
En Europe, entre l’écrivain et le lecteur, il y a beaucoup d’intermédiaires. Toute une industrie. Et cette industrie a pris une place si prépondérante qu’on ne parle plus de l’auteur d’un livre, mais de son éditeur, et de plus en plus de son diffuseur. Le jeune écrivain dira avec fierté qu’il vient de publier son livre chez Gallimard ou Grasset. On le félicite d’avoir été choisi par un tel éditeur. Un écrivain est reconnu comme tel quand on cite son nom avant celui de son éditeur. Pour certains, une littérature ne dure que si elle est publiée en Europe. Alors c’est un livre selon les règles de l’art de l’édition, c’est-à-dire avec une sortie bien ordonnée, à des moments précis de l’année, comme la rentrée de septembre, la rentrée de janvier, les livres d’été, les poches. Et tout cela reste conditionné par l’esprit marchand… C’est tout de même étrange que la littérature pure, celle qui passe des mains de l’écrivain aux mains du lecteur, soit relayée au second plan, comme n’étant pas de la littérature, et que la seule littérature qui compte soit celle que l’industrie domine.
C’est l’écueil des activités humaines où l’industrialisation impose un modèle unique. Dans l’agriculture, en Haïti, entre le producteur et le consommateur, le circuit est court. Quand j’achète une mangue…
La mangue est passée seulement entre une ou deux mains. Souvent le propriétaire du manguier et la marchande qui vous la vend.
Selon les critères occidentaux, c’est même considéré comme de l’activité informelle, mais la mangue est délicieuse !
Quel luxe !
La mangue est bio, elle est exquise.
Eh oui, c’est le grand luxe !

Makenzy Orcel, Néhémy-Pierre Dahomey, Gary Victor, Dany Laferrière, Louis-Philippe Dalembert, Emmelie Prophète, Felwine Sarr, James Noël, Ayiti la !, Les lettres haïtiennes en mouvement, Jardin botanique, Bruxelles 8 juin 2017
Pour en revenir à la littérature haïtienne, entre celui qui produit ou fait fiction, c’est-à-dire s’inscrit dans une des plus vieilles activités humaines qui soit et celui qui lit, qui apprécie le texte…
Il y a moins d’intermédiaires, moins de goûts particuliers et tous ces goûts, nous savons bien qu’ils sont dominés par l’esprit marchand.
Des goûts particuliers ?
Par exemple, vous écrivez sur tel sujet, on vous dit, attendez, je vais vous publier, il y a deux autres livres qui vont paraître dans le même sens et vous ferez un petit cortège. Il faut rassembler les produits qui se ressemblent afin d’avoir un meilleur impact dans la librairie. Ce qui permettra à la critique de mieux se retrouver. D’ailleurs, c’est devenu un rituel, à la rentrée littéraire, on entend : ah ! Les romans de guerre sont arrivés, ou les romans sur l’Algérie ou c’est l’année de l’autofiction féminine. Les chroniqueurs cherchent désespérément à expliquer ces micros phénomènes. Ce qu’on oublie de dire c’est que tous ces classements sont pensés pour permettre une plus rapide visibilité de l’objet qu’on cherche à vendre. Quand j’étais enfant et adolescent, j’avais un tailleur, comme tous mes voisins. J’avais un cordonnier, comme tous mes voisins. Pas si riche ! Il y avait un cireur de chaussures qui passait, le dimanche, pour cirer nos chaussures, comme tous mes voisins. Pas si riche ! D’ailleurs, il cirait les chaussures de toute la rue. Des deux rangées. Il a terminé une rangée, il traverse et cire de l’autre côté. Puis, un moment donné, on a commencé à vendre beaucoup de chemises toutes faites, beaucoup de chaussures à bon marché, des marchandises achetées à l’étranger et résultat tous ces artisans ont fait faillite. C’est ainsi qu’un art de vivre est parti en fumée.

James Noël, Dany Laferrière, Ayiti la !, Les lettres haïtiennes en mouvement, Jardin botanique, Bruxelles 8 juin 2017
Réduit à néant par les biens marchands fabriqués en série…
Vous n’étiez pas du tout considéré comme riche si vous aviez un tailleur ou un cordonnier. Il fallait acheter ses vêtements dans les magasins du centre-ville. Les vêtements chers venaient d’Europe et ceux à bon marché venaient des États-Unis – c’était du luxe ! Quand j’ai dit à Montréal que j’avais un tailleur et un cordonnier à Port-au-Prince les gens se sont exclamés : oh le privilégié ! On s’était trompé. Il est vrai que c’était une situation paradoxale où la chose artisanale était moins considérée que le produit industriel. De même quand on dit miracle littéraire haïtien, c’est parce qu’on a l’impression que la littérature haïtienne est entrée dans le champ commercial.
Récemment, je parlais de la notion de fraternité avec un ami qui m’a soutenu que c’est parce que les esclaves étaient dans la souffrance qu’ils se sentaient frères. C’est en raison de la souffrance partagée que les Noirs s’appellent frères. Mais la fraternité que le peuple de Saint-Domingue est venu plaider devant la Convention montagnarde, en 1793, est d’abord un concept sociopolitique valorisé par beaucoup de cultures du continent africain. Les captifs, ayant survécu à la déportation, à la traversée du gouffre atlantique qui les transforme en esclaves, ont conservé la mémoire de la nécessité de la fraternité… Quand en Haïti, on fait la littérature autrement, est-ce cette conscience qui s’oppose à la marchandisation du livre ?
C’est aussi notre désastreuse condition économique, pas uniquement, mais c’est ça aussi qui nous a protégés de cet esprit mercantile. Je dis souvent que la pauvreté jusqu’à un certain point peut protéger. Elle peut protéger d’une ambition excessive. Je n’ignore pas les ravages de cette catastrophe socio-économique en Haïti, je veux simplement qu’on ait un espace vierge qu’il faudra exploiter avec intelligence. Ne pas foncer tête baissée dans le tourisme si on n’a pas les moyens pour éviter le tourisme sexuel. Dès qu’on dépasse certains seuils, on entre dans une autre réalité. Quelqu’un, vivant en Amérique du Nord et qui veut aller dans les Antilles, eh bien, il y va pour le soleil, pour la mer, pour les plages et le farniente… Mais ça ne peut pas durer deux semaines, il lui faudrait visiter quelques musées aussi, des monuments nationaux, aller voir aussi des pièces de théâtre. Un vrai choix. C’est la seule chose qui pourrait contenir le tourisme sexuel. Je me souviens en Haïti, quand j’étais jeune journaliste, le gouvernement lançait une campagne qui nous demandait de sourire aux touristes, elle a échoué assez vite, car on n’oblige pas un Haïtien à sourire. Il ne faut pas demander aux Haïtiens de sourire ! Il suffit qu’on leur commande de le faire pour qu’ils refusent. Nous reste cette autonomie. Beaucoup de peuples plus riches que nous ont accepté de jouer le jeu et de sourire. Mais les Haïtiens y voient une question de dignité. Les autres, comme la Jamaïque et la République dominicaine, ont augmenté leurs revenus au point de ne pas pouvoir revenir en arrière. Sans cette industrie, c’est la faillite. Les voilà qui sourient.

Dany Laferrière lisant Chronique de la dérive douce, Ayiti la !, Les lettres haïtiennes en mouvement, Jardin botanique, Bruxelles 8 juin 2017
Ils sont sous domination touristique. Une intuition me fait relier ce que vous expliquez à cette phrase magnifique dans L’énigme du retour : La chose la plus subversive qui soit, et je passe ma vie à le dire, c’est de tout faire pour être heureux à la barbe du dictateur. Cette joie, cette résistance radieuse, est politique, n’est-ce pas ?
Ah, totalement ! Totalement ! Et c’est ça, précisément, qui a sauvé Haïti. Ce n’est pas du tout une joie folklorique. C’est une vraie joie humaine qui a échappé au dictateur et qui l’a laissé dans son espace de tristesse et qui l’a exilé de la vie. Le dictateur est devenu l’exilé. Celui qui est exilé de la vie, du centre d’intérêt des choses intéressantes. Quand vous regardez les gens, ils sont vivants, ils sont heureux… vous pouvez passer dans une limousine, vous pouvez avoir des millions, vous ne pouvez pas ne pas être nostalgique de ce moment de fluidité dans votre vie. Du jour où vous avez été heureux avec rien, c’est-à-dire avec votre rythme intérieur seulement, une sorte d’explosion, de relâchement à l’autre qui accueillait ces étincelles de joie. Et ça, tous ceux qui ne l’ont pas l’envient. Et dès que vous l’enviez, vous n’êtes plus dans le cercle. Il faut dire aussi que c’est politique dans le sens que le dictateur veut absolument agir sur vos émotions. Ça ne l’intéresse pas que vous soyez pour ou contre lui. Le dictateur, ce qui l’intéresse, c’est que vous soyez obsédé par lui. Obsédé pour, un militant, obsédé contre, un opposant…
Il veut fasciner ?
Oui, c’est ça. Il veut fasciner ! C’est le diable. C’est l’adversaire, comme on dit. Il veut fasciner. Il veut vous emmener dans l’adversité précisément. Et dès que vous lui échappez, dès que vous quittez son champ magnétique, il ne peut rien contre vous. Vous êtes libre. Et cela malgré la misère qu’il a créée de manière artificielle. C’est une misère artificielle du fait qu’elle pourrait être résolue par la fraternité justement. Mais le dictateur veille au grain en faisant germer la division dans la société. Mais si vous arrivez à être heureux, c’est un acte subversif !

Dany Laferrière, Week-end Hommage à James Baldwin, auditorium Jean Rouch, musée de l’Homme de Paris, 9 décembre 2017
C’est cette joie qu’on voit sur la figure de James Baldwin ?
Elle ne l’a jamais quitté même dans les moments les plus graves.

Dany Laferrière, Chrystel Bonfils Doziass, Samuel Légitimus et Mathilda Légitimus-Schleicher devant l’auditorium Jean Rouch, Week-end Hommage à James Baldwin, musée de l’Homme, 9 décembre 2017
Cette joie d’échapper à ce qu’on a organisé comme malheur…
Et puis une joie qu’il a aussi tout simplement et qui est une résistance intérieure. Cette joie profondément enfouie en lui et qui l’a toujours empêché de sombrer dans le désespoir. Il y a une grande force aussi dans cette capacité d’exprimer par la littérature ses émotions les plus secrètes.

Dany Laferrière et Rodney Saint-Éloi, Ayiti la !, Les lettres haïtiennes en mouvement, Jardin botanique, Bruxelles, 8 juin 2017
La fraternité ne peut pas être que de souffrance, c’est une joie d’exister aussi en tant qu’être humain.
La souffrance, l’Histoire ne nous l’a pas épargnée. Chacun souffre à sa manière, certains c’est pendant, d’autres c’est après. C’est clair quand on découvre le prix à payer, par exemple pour la colonisation, oui, le prix à payer est terrifiant après la colonisation ! Moi, il n’y a pas de jour où je n’essaie pas de consoler un pauvre blanc qui se sent mal, mal que ses pères aient fait ça. L’après-colonisation est terrifiante… terrifiante pour les anciens colonisateurs et leurs descendants. Il faut les consoler ! On parle de culture et de littérature postcoloniales, puis on s’intéresse uniquement à la Jamaïque, à Haïti, à certains pays africains. La littérature postcoloniale, c’est en Occident qu’il faut aller la chercher. Parce que, quand on a été victime, quand on a été écrasés, on peut plus facilement oublier que si on a été bourreau. Or, on n’a jamais analysé l’impact de cela sur la psyché de celui qui tenait le fouet. De cette douleur, de cette culpabilité profonde, il faudrait en parler un jour afin de traiter cette névrose coloniale. De toute façon, les blessures dont on ne parle pas ne se cicatrisent pas.

Alain Mabanckou et Dany Laferrière, colloque « Penser et écrire l’Afrique aujourd’hui », Collège de France, amphithéâtre Marguerite de Navarre, 2 mai 2016
Ce qui s’est passé dans les colonies, cette violence n’est jamais restée dans les colonies. Ce qui se vit dans les familles que je connais, en Belgique, en France, est hanté par cet impensé. Le lien, les liens ne sont pas faits. Par exemple, dans les sociétés occidentales où les entreprises discriminent les Noirs, elles peinent aussi à embaucher les homosexuels, les personnes en situation de handicap, les intersexués, etc. Quelle population reste-t-il après exclusion d’une part de la richesse humaine ? Des Blancs, femmes, souvent subalternes, qui disent être harcelées et épuisées…
Bien sûr !
… et une population d’hommes malheureux qui disent pourquoi on ne nous aime pas.
Et à laquelle on enlève le droit de protester parce que cette population n’a aucune mythologie individuelle. Elle ne peut pas dire : nous sommes Noirs, nous sommes homosexuels, nous sommes femmes ! Elle n’a aucun discours sur lequel s’appuyer, elle ne dit rien ! Cette population d’hommes ne dit rien. Un jour, quand ils se mettront à parler, nous saurons que le prix à payer était très cher comme on a su pour ces femmes les plus lumineuses du monde, les actrices de Hollywood, souriantes, lumineuses, puissantes même, c’est certain, qui disent que presque n’importe qui les a touchées et qu’elles se sont tues pendant… Pendant trente ans ! Trente ans… Trente ans, effrayées ! Même la dictature des Duvalier, on l’a foutue à la porte après vingt-neuf ans !

Dany Laferrière, colloque « Penser et écrire l’Afrique aujourd’hui », Collège de France, amphithéâtre Marguerite de Navarre, Paris, 2 mai 2016
Cette violence dure d’être inaperçue…
Et, surtout, d’être bien plus forte qu’on ne le croit. Tellement plus forte !
Quand on agit ainsi depuis des siècles, n’est-ce pas comparable à la colonisation qui décivilise aussi le civilisateur ?
On est décivilisé d’abord. On ne peut pas faire ça en restant humain. Ce qui veut dire que l’ennemi est dans la maison… Comme pour le père de James Baldwin ! L’ennemi est dans la maison avec ce père qui avait absorbé toute cette humiliation jusqu’à en être structuré par une sorte de violence contraire, de haine contraire. Parce qu’on peut être ainsi ! Et trop haïr, c’est être complètement empoisonné. C’est pour ça que les jeunes gens, plus d’ailleurs en Occident, quittent la maison si tôt, parce que l’ennemi est dans la maison… C’est-à-dire il n’y a pas de possibilité de faire ceci, comme vous dites, ici et de faire cela, là. Le pire, c’est qu’on ne le sait même pas ! On croit qu’on peut le faire. On croit que là, on est arrivé, que revenu chez soi dans une petite ville française ou belge, on va agir autrement et ce n’est pas vrai. Ce n’est pas vrai ! On l’a vu pour les soldats qui revenaient de la guerre du Vietnam, tous pourris. Ils n’arrivaient pas à dormir. Ils étaient en état de stress, de burn-out. Et le taux de suicide ! Le taux de suicide énorme ! Nous parlons de ça : d’une société qui envoie ses enfants, dans des conditions si effrayantes, faire des choses, des choses qui ne sont pas permises chez elle. Et ce, sans restriction. Puis, quand les gens refusaient de tuer, on leur donnait des drogues. On les bourrait de toutes sortes de substances afin qu’ils puissent trouver ça naturel et, après, ils reviennent à la maison comme si rien ne s’était passé. En fait, ce sont des bombes à retardement.

Alain Mabanckou et Dany Laferrière, colloque « Penser et écrire l’Afrique aujourd’hui », Collège de France, amphithéâtre Marguerite de Navarre, Paris, 2 mai 2016
Si je vous comprends bien, concernant les guerres de colonisations, il faudrait réfléchir profondément au mal qu’elles ont pu faire à toutes les populations, de la même façon qu’on le fait pour la guerre de 14-18 dans laquelle j’ai deux arrière-grands-pères qui ont combattu et puis la guerre de 39-45 qu’ont vécue mes grands-parents. Or, il semble que, pour la colonisation, la réflexion s’arrête…
C’est parce qu’on dit que ce n’est pas une guerre ! Et c’est ça le problème. D’ailleurs, on l’a vu avec la guerre d’Irak ! Les États-Unis, officiellement, n’ont pas fait de guerres depuis le Vietnam. Je me demande même si la Corée était une guerre pour les Américains… Parce qu’il y a cette chose fabuleuse, en Occident, consistant à dire : il faut que l’Assemblée nationale ou le Sénat, par exemple, pour les États-Unis, déclare officiellement la guerre. Il y a eu une guerre qu’ils ont été obligés de déclarer pour l’Irak jusqu’à ce que – et on l’a su alors, Bush a dit : la guerre est terminée. Et cette déclaration montre l’arrogance, le fait qu’on puisse terminer une guerre d’un seul côté, sans signer, parce qu’ils ne prennent pas ces gens, oui, l’autre partie assez au sérieux pour que ce soit une guerre. Ils font comme ils veulent. La question, c’est qui dit si un acte est légal ou pas ? Qui possède le sceau qui donne le droit d’agir ?

Dany Laferrière pendant un entracte du colloque « Penser et écrire l’Afrique aujourd’hui », Collège de France, amphithéâtre Marguerite de Navarre, Paris, 2 mai 2016
La colonisation, ici, beaucoup n’imaginent pas que ce sont des guerres avec une occupation…
Haïti, par exemple, qui a fini par être indépendant après une guerre coloniale violente, contre une armée exceptionnelle, celle de Napoléon Bonaparte, eh bien, on a oublié. Ils ont une technique…
Une technique ?
Une technique d’oubli. J’ai vu dans la presse française, quand ils ont mis des dates importantes d’Haïti, en 2004, ils ont oublié, je n’ai pas vu le 1er janvier 1804.

Dany Laferrière, Rodney Saint-Éloi, Raoul Peck, Ayoko Mensah, Rencontre littéraire : Haïti, diversité et enjeux d’écriture, Maison du Livre, Bruxelles, 19 février 2016
Ils ont oublié la… ?
C’est-à-dire que c’est précisément ça, une technique pour laisser un pays vide de mythologie, vide d’histoire ! Ils ont mis des dates et, pour eux, la grande date, c’est 1791, la révolte des esclaves qui est liée, directement, à 1789 et qui est la Révolution française. Donc, ils n’ont pas mis le moment où Haïti est devenu indépendant. Le 1er janvier 1804, ils ne l’ont pas mis. Cette date n’existe pas.
Il n’y a pas l’admiration pour Haïti que j’ai ressentie, par exemple, au Vietnam où, lorsque je disais être Haïtienne par ma mère, ils étaient heureux de répondre, vous avez fait comme nous ! Vous avez chassé deux puissances impériales. Et ces Vietnamiens ajoutaient : mais vous, vous l’avez fait avant nous !
Avant tout le monde, d’ailleurs ! En 1804, c’est la première fois qu’un peuple s’est déchargé de cette masse qui pesait sur son corps, son cœur, son esprit, après s’être érigée en système : l’esclavage. Et pour instituer la république. Par conséquent, c’est une situation nouvelle : ce ne sont pas juste des êtres libres. Bien sûr, tout a été fait pour qu’on oublie cette date de naissance. Cette date de naissance d’un peuple, car il ne s’agissait pas uniquement d’Haïti dans cette affaire. Il s’agissait de tous les damnés. Donc quelqu’un qui n’a pas de date de naissance, c’est une feuille livrée au gré du vent. Elle n’a pas d’histoire.
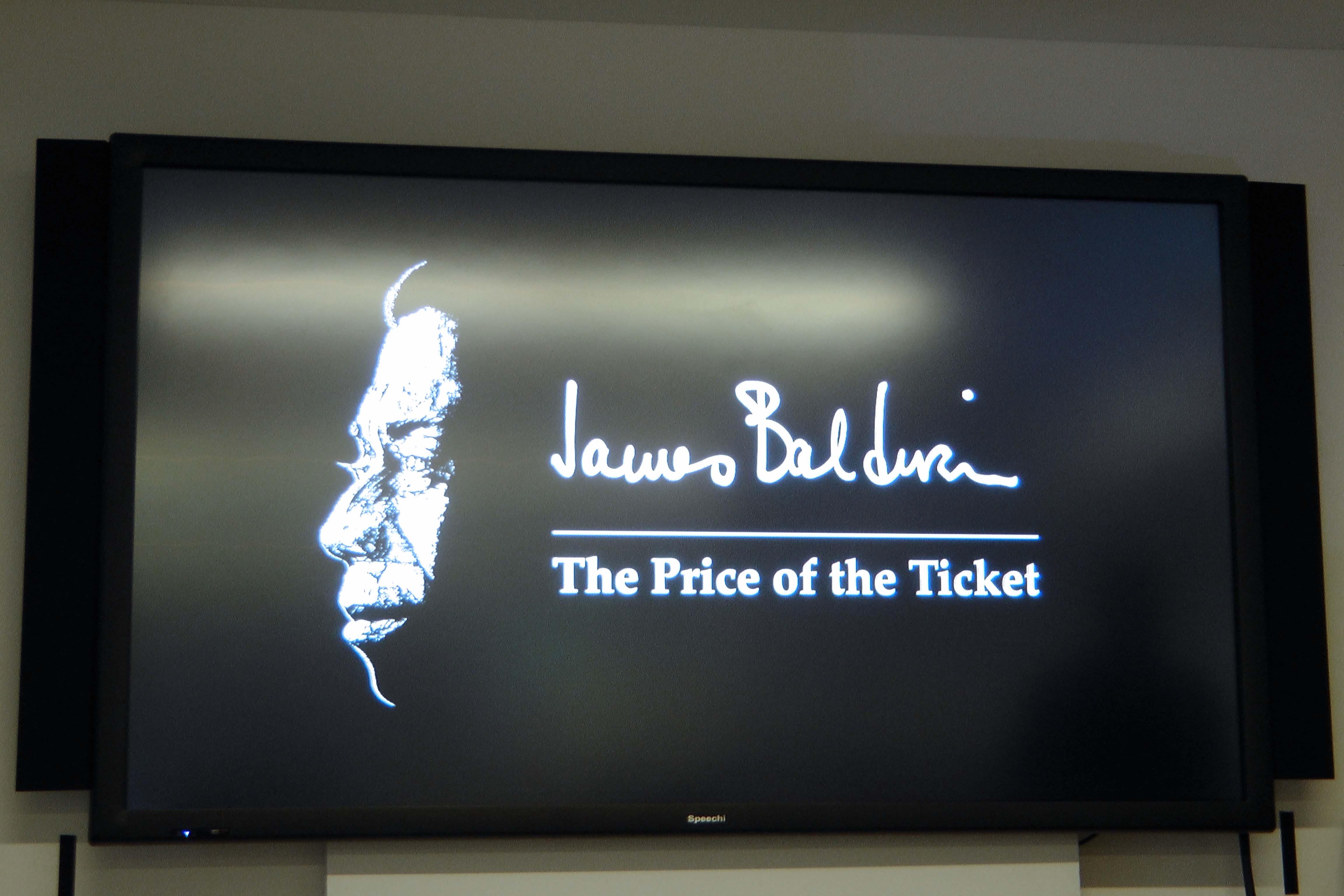
The Price of the Ticket, long métrage documentaire de Karen Thorsen (article, en 2 partie, sur la projection du 3 juin 2017 au musée de l’Homme, ici et ici)

James Baldwin répond à Paul Weiss, professeur de philosophie ayant, notamment, enseigné à Yale (voir l’extrait vidéo ici)
Pas d’identité, pas de réalité…
James Baldwin l’a bien dit ! Il l’a mis en évidence dans sa réponse à ce professeur, durant l’émission télévisée dont on voit un extrait dans le documentaire de Karen Thorsen The Price Of The Ticket. Baldwin dit : ça ne m’intéresse pas, c’est important, mais ce n’est pas si important de savoir que vous n’êtes pas raciste. Et peut-être même que vous ne l’êtes pas. Mais ce qui est important, c’est quand je vois vos institutions, vous ne me comptez pas. Ce n’est pas important de savoir que vous n’êtes pas courtois, que vous êtes courtois ou gentil, vous personnellement ou individuellement, mais quand je vois vos institutions, je ne me vois pas. Et ça, c’est le résultat ! Que les gens disent, j’aime, je n’aime pas, qu’on s’émeut, par exemple, du tremblement de terre… Oui, mais ce qui est clair, c’est que les Haïtiens ne peuvent pas facilement entrer en France. Donc voilà ce qui m’intéresse, la question : Que fait-on quand les hommes politiques voudraient bien paraître généreux et que les institutions refusent ? Dois-je croire que c’est parfois un théâtre ? On dit oui sachant que l’autre dira non.
Comment fait-on, dans ces conditions, pour circuler, pour travailler, pour être un corps qui accomplit des actes… ?
Des actes citoyens inscrits dans un espace légal pourtant. On est toujours sur le qui-vive, n’étant jamais sûr d’être dans la légalité.

Tout ce qu’on ne te dira pas, Mongo de Dany Laferrière, paru chez Mémoire d’encrier en 2015
Jamais sûr que ses droits sont réels et pas illusoires.
C’est pour ça que j’ai écrit un livre qui s’appelle Tout ce qu’on ne te dira pas, Mongo où j’explique, à un jeune Camerounais, comment s’insérer dans la société. Et je lui dis, précisément, au début, vous allez voir, les gens attendent l’autobus, font la queue, vous pouvez monter sans la faire, ils ne vous voient pas. Mais si vous agissez ainsi, vous retardez votre entrée dans la société. En fait, les gens vous voient, ils vous voient toujours. Ne leur donnez pas raison de continuer à faire semblant de ne pas vous avoir vu. Mais si vous allez de manière ostentatoire à la queue, à la fin de la ligne, ils vont noter le geste. Ils sont prêts à vous faire des passe-droits, mais méfiez-vous, c’est peut-être une façon de vous garder hors de la légalité. N’acceptez pas qu’on vous aime. Ce qui prime, ce qui est important, c’est se trouver sous la protection de la loi. Être dans la société, comme vous dites, un corps qui travaille, un corps qui mange, un corps qui boit, qui aime, qui déteste… Un corps légal même ou un corps humain dans un espace légal ! Donc, il faut prendre en considération toutes les lenteurs, tous les problèmes que pose la société même si vous n’en avez pas encore les intérêts ou les privilèges. Il vous faut respecter la loi avant qu’elle ne vous respecte, parce que c’est comme ça que vous pourrez vous insérer dans la société. Dès lors, c’est très important de se percevoir même si on n’est pas encore vu. Et là, j’ai remarqué que les sociétés sont prêtes à tout pour que vous n’entriez pas dans cet espace légal. Dans les sociétés occidentales, ils sont prêts à vous donner plus qu’ils ne donnent aux citoyens locaux pour vous garder dans cet espace. Refusez ! Refusez-le, sous peine de disparaître de votre propre vue.
C’est de la bienveillance inégale, non réciproque ?
Bien sûr, car l’autre va l’apercevoir aussi et c’est ce qui l’incline à dire qu’il se sent moins citoyen parce qu’il obéit aux règles, qu’il souffre des difficultés inhérentes à cela – on ne se sent plus chez soi, dans son pays parce que des gens qui viennent d’on ne sait où semblent être mieux traités. Oui ! Et quand il lit, dans les journaux, des mensonges, parfois aussi, affirmant qu’il y a plein de gens qui viennent d’arriver et qu’on va, par exemple, leur ouvrir un hôtel, un centre d’hébergement, et ce n’est pas forcément vrai, mais quand lui voit ces choses, au fond, là, ça n’avance pas, parce que ce n’est pas de la considération. Non ! Parce que les nouveaux venus, cette dynamique les éloigne de l’espace légal. Ça les en écarte ! Or c’est ça le combat ! Le combat, c’est entrer dans cet espace légal et d’y avoir un corps identifié, un corps réel, un corps qui souffre, qui chante, qui travaille, qui pleure, qui danse… Un vrai corps pour pouvoir se percevoir, se sentir soi-même. Parce que c’est pour soi !

Dany Laferrière, Rodney Saint-Éloi, Raoul Peck, Ayoko Mensah, Rencontre littéraire : Haïti, diversité et enjeux d’écriture, Maison du Livre, Bruxelles, 19 février 2016
Je comprends, c’est le défi, être un corps complexe en lien avec l’être complexe des autres corps…
Vous savez, il y a une vingtaine d’années, je cherchais un logement à louer à Montréal et je suis rentré dans un immeuble. Le concierge n’était pas dans la loge où il devait être, mais il était indiqué sur la porte d’aller le trouver chez lui. Alors, je m’y rends. Il y avait cinq ou six personnes, dont le concierge qui était en train de boire avec des amis. J’ai dit que je voudrais louer un appartement. Il m’a dit : écoutez, monsieur, on ne loue pas aux Noirs. J’ai demandé pourquoi. Il m’a répondu : c’est le propriétaire qui veut ça. On ne loue pas aux Noirs, ici, et c’est une règle, comme une autre, voilà ! Je me suis tourné vers le reste du groupe et j’ai dit : est-ce que vous êtes d’accord ? Ça a été la révolution. Je suis resté trois heures. Et j’ai eu le logement. Au début, les gens étaient étonnés, ils ont dit, mais c’est le travail du type. Il fait son travail. Il vous l’a dit, c’est le propriétaire. J’ai dit, mais est-ce que les choses peuvent aller jusque-là : le propriétaire peut lui dire de tuer quelqu’un et il obéit ? Est-ce que le concierge ne peut pas être protégé par l’État ? Est-ce que le propriétaire est plus important que l’État, parce que l’État dit, non, on ne le peut pas, on ne peut pas dire : je ne loue pas aux Noirs et, pourtant, le concierge obéit au propriétaire et refuse d’obéir à l’État ? Je vous le dis, simplement, en termes courtois. J’ai entendu ce que le propriétaire exige. Je vais partir, il y a des centaines d’autres appartements à louer. Et je ne veux pas créer un malaise. Si je vous dis ça, c’est que je veux comprendre ! Le groupe demande, qu’est-ce que vous voulez comprendre, c’est très simple ! Je réponds, non, je ne veux pas comprendre le racisme et ce qu’il m’a dit, je comprends le racisme, monsieur. Je veux comprendre pourquoi vous ne trouvez pas important que vous vous mêliez de ça. Et cette parole a déclenché la discussion.

Dany Laferrière, parrain du Week-end Hommage à James Baldwin, auditorium Jean Rouch, musée de l’Homme de Paris, 9 décembre 2017
La parole demandant pourquoi l’inquiétude n’est pas partagée ?
Oui ! Ça a déclenché une discussion ! Une longue discussion ! Il y avait deux types, assis sur le divan, qui, immédiatement, on dit, non, non, on n’est pas d’accord. Ensuite, la discussion a rebondi sur le cas de figure de la Deuxième Guerre mondiale et de tous ces Allemands qui ont dit, non, moi, je travaillais, juste, dans un bureau. Au fond, ils ont eu le même genre de débat qu’il y a pu avoir après la Seconde Guerre mondiale, la même discussion sur la culpabilité. Jusqu’où on doit obéir aux ordres ? On a eu la même discussion, faite cette fois par des gens qui étaient en train de boire depuis un moment, mais avec la même passion et discutant de choses, des questions qui rappellent Platon. Ces gens, pour autant que je puisse l’évaluer, étaient de peu d’école. Je ne les sentais pas avoir poussé loin les études. Mais les gens aiment beaucoup discuter de ça, c’est un problème très profond. Et on ne leur demande pas souvent d’en discuter. On le demande souvent à la victime, oui. Mais aux autres, on ne leur offre pas assez l’occasion de le faire. On a, même, fait un petit quiz : êtes-vous raciste ?, c’est un petit film qu’on trouve sur Internet. À la fin, le concierge était le moins d’accord avec lui-même, je veux dire, comparé aux autres. Comme je l’ai questionné, l’ai appelé à discuter, tout bien considéré, il est apparu qu’il n’était pas d’accord avec le fait d’avoir à obéir à son propriétaire. Pas parce que ce propriétaire, il a dit, n’était pas très bon, mais parce qu’il n’était pas un type sérieux : il ne payait pas bien, il ne donnait pas d’argent pour le chauffage. Donc, le concierge obéissait à quelqu’un qui, selon lui, ne le méritait pas. La discussion a révélé ça. C’est intéressant, n’est-ce pas ? Intéressant, comment les choses débordent. Voilà la raison pour laquelle il est tellement important de faire discuter tout le monde. Parce que, alors, on voit qui paie le prix le plus fort. Peut-être, c’est le concierge qui dit être mal rétribué, que le propriétaire fait des problèmes tout le temps, le réveille n’importe quand… l’insulte parce qu’il a oublié de remplacer un carreau à la salle de bains.
Ce propriétaire qui refuse de louer un appartement aux Noirs, le concierge doit vivre avec lui, au quotidien. C’est toute une histoire aussi ! Je me souviens avoir, un jour, raconté, à un ami dessinateur de BD, une expérience pénible vécue avec une maison d’édition. L’ami dessinateur a répondu qu’il travaillait avec ce genre de personne. Il avait affaire à elles. Il a dit, je sais que tu as subi un dommage, mais tu t’en rends compte, quand on est obligé de faire avec ces gens… On a pu discuter de ceux qui sont, comment dire, faussement de l’autre côté, des faux privilégiés. Certains présupposés masquent…
Parce que, d’abord, c’est la question de qui a droit à la parole. Et j’en reviens au constat que ce n’est pas toujours ceux qu’on croit qui peuvent prendre la parole. Quand même, on a entendu dernièrement cet aveu terrible fait par les personnes les plus puissantes du monde du spectacle… des femmes de producteurs, des actrices admirées, puissantes qui disent avoir été humiliées ou violées… humiliées durant trente ans ! Elles n’ont pas pu parler, alors que l’image qu’elles donnent, toute leur image, c’est l’image de gens qui sont au pouvoir. Alors, on se dit que la chose est encore plus grave qu’on le croit ! Et nous réunit à des profondeurs qu’on ne soupçonnait pas.
De ce point de vue, on est tous liés ! Il n’y a pas de frontière.
Dany Laferrière : Il n’y a pas de frontière ! Et c’est ce que vous avez dit, on ne peut pas faire ceci ici et faire cela, là-bas. Non ! On ne change pas de nature facilement !

Dany Laferrière, Rencontre littéraire : Haïti, diversité et enjeux d’écriture, Maison du Livre, Bruxelles, 19 février 2016
Cher tout le monde, femmes, hommes et tant d’autres, il y a presque deux ans jour pour jour, le premier article du blog était consacré à une rencontre-lecture réunissant Dany Laferrière, le cinéaste Raoul Peck et le poète et éditeur Rodney Saint-Éloi. Alors, je vous invite à revenir au tout début du voyage des Vagabonds sans trêves (ici) et à poursuivre avec l’article consacré au Week-end Hommage à James Baldwin (ici), sans oublier la vidéo publiée par le musée de l’Homme de Paris (ici).
Lutte contre le racisme, le sexisme, l’homophobie et les diverses formes d’infériorisation des êtres humains, est-ce la bonne formulation ? Car il s’agit moins d’un combat que d’un dépassement des bornes commençant en soi. Accorder à l’autre le prestige d’être le connaissant d’une multiplicité d’expériences dont on ignore le point de vue, c’est se libérer, c’est s’évader de ses a priori dualistes (noir-blanc, homme-femme, homo-hétéro…), c’est préférer l’élargissement de la découverte et la nuance de la rencontre aux lieux de figement où, comme le philosophe français Gilles Deleuze dit, à propos du formatage des débats télévisés :
Même quand on croit parler pour soi, on parle toujours à la place de quelqu’un d’autre qui ne pourra pas parler. (Dialogues, Champs Flammarion, p. 28)
On se quitte avec le formidable guitariste, auteur, compositeur et chanteur américain Ben Harper et With my own two hands :
I can change the world
Je peux changer le monde
With my own two hands
Avec mes deux mains
Make a better place
Je peux faire un meilleur endroit
With my own two hands
Avec mes deux mains
Make a kinder place
Je peux faire un endroit plus gentil
With my own two hands
Avec mes deux mains

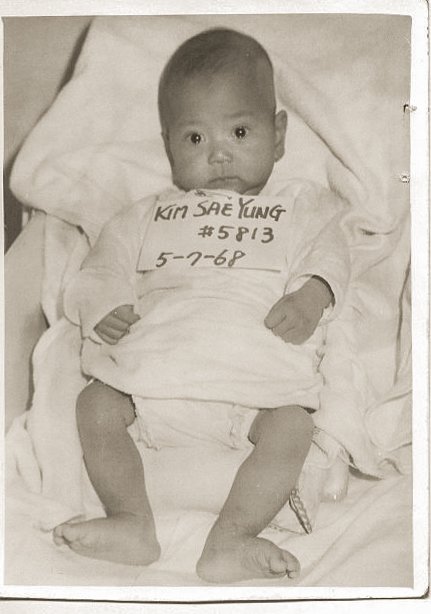

0 commentaires