Ces petites noirceurs qui éclairent nos âmes d’adulte
Cher tout le monde, femmes, hommes et tant d’autres, le blog est heureux d’héberger un invité vagabond : l’écrivain Guy Alexandre Sounda qui propose sa lecture d’Enfances, le recueil de nouvelles de Ralphanie Mwana Kongo, paru en novembre 2017.
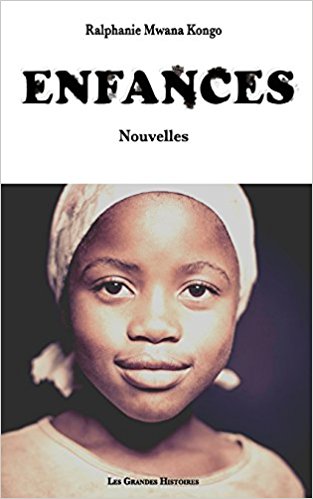
Enfances de Ralphanie Mwana Kongo, éditions Les Grandes Histoires, 2017
Guy Alexandre Sounda : Des histoires courtes écrites simplement. Pas de fioritures dans la narration ni de formules emphatiques entre les lignes, tout se tient dans le ton et à travers le temps. Le ton d’une auteure qui égrappe des mots nus et sincères sous lesquels on entend des voix susurrer à chaud. Des voix d’enfants prises entre les frasques d’un monde à la fois coriace et fragile et des voix d’adultes ancrées dans le tourment et la bagatelle. Le temps qui passe d’une heure à une autre sans transition, d’un âge vers un autre et d’un lieu à l’autre, comme une urgence, une poésie de l’immanent.
La simplicité est la complexité résolue disait Brancusi, le sculpteur roumain. En écrivant ces nouvelles sur le thème de l’enfance, Ralphanie Mwana Kongo signe là, de la plus simple des manières, un beau manifeste sur nos identités complexes.

Ralphanie Mwana Kongo
Tout commence par ce petit paragraphe qui en dit long sur le projet de l’auteure et sur les récits qui suivront :
J’ai été heureuse jusqu’à l’âge de six ans, après cela je n’ai plus connu le bonheur et la pleine sérénité qu’il procure. J’étais heureuse et je l’ignorais ; ce n’est qu’une fois que le soleil vous a fui, quand jamais plus il n’apparaîtra dans votre vie que vous réalisez combien il a brillé et de quel éclat il a illuminé vos journées ; vous y repensez, mais tout cela est loin, inaccessible et perdu. (p. 9)
Ainsi parle la petite fille écartelée entre son père et sa mère, comme l’indique si bien le titre de cette première nouvelle : Entre père et mère. Une parenthèse où poussent les colères secrètes et impuissantes d’une enfant révoltée d’une part par les incartades d’un père frivole et chagriné d’autre part par les heurts d’une mère distante.
Je dirais : une parenthèse des possibles dont l’enfant se servira pour deviner à sa façon les mondes qui le murent. Mondes pavés de désirs inassouvis. Mondes de promesses non tenues et de rancunes non digérées. Elle s’en servira pour bâtir une carapace au fond d’elle-même, loin des regards. Bonheur gâché à jamais. Soleil inaccessible dorénavant. Frustrations celées. Autant des pistes que l’enfant croquera de maux en mots pour atteindre ces lumières qui lui manquent tellement et qu’aucun adulte ne semble disposé à lui apporter pour l’instant. Des lumières que seul sait allumer l’amour lorsque au sommet du coteau les jours s’éteignent et que les ciels se couvrent. Cette première nouvelle explore avec sensibilité les mille et un déboires qui surviennent dans un foyer et que profondément les enfants subissent après que leurs parents se sont séparés. Une manière de souligner que nos propres drames se logent aussi dans les cœurs de nos enfants et que l’amour demeure, en tout temps et en tout lieu, notre seul rempart. Raison pour laquelle elle s’achève sur un ton optimiste :
Mon père m’aime ; je ne suis pas seule. J’ai de nombreuses qualités. Jamais plus je ne laisserai un garçon et aucune autre personne me faire douter de ma valeur. Je me battrai pour me construire une vie heureuse et mon avenir sera éclatant, je m’en fais le serment. (p. 31)

Wax Lolo, Romuald Hazoumè (Bénin), 2009, The October Gallery (London), octobergallery.co.uk
La seconde nouvelle : Savimbi. Tragique et cocasse. Trop vite fermée à mon goût, comme si l’auteure avait eu soudain peur du tableau qu’elle était en train d’ébaucher et des effluences qui en découleraient. Des enfants de rue qui sont livrés au hasard d’une vie sans ciel et se battent comme de beaux diables pour s’extraire de l’étau de la misère. Ils s’accrochent à leurs crottes et s’inventent leurs propres mondes avec des morceaux de ficelle. Il y avait là un moyen de creuser davantage et de fouiner au plus près de la boue pour en sortir des éclats de verre. Elle est néanmoins très réussie et glose dans un souffle précipité les odeurs tenaces d’une société qui se bouche les pores et écrabouille ses propres enfants. Savimbi est le héros de cette histoire. Orphelin de mère. Largué chez son oncle après une chicane avec la nouvelle femme de son père, il a atterri dans la rue avec la colère au ventre. Chef d’une bande de gamins sans lendemain comme lui, il a décidé d’être méchant pour vivre le plus longtemps possible. Touché par la disparition de la mère Maguy, une dame au grand cœur qui leur offrait un bol de bouillie chaque soir, il se dit :
Il est sûrement écrit quelque part que les personnes qui font du bien doivent partir très tôt et laisser inachevée l’œuvre de charité qu’elles ont commencée. C’est le bon Dieu, s’il existe, qui en a sans doute décidé ainsi. Il faut que la souffrance demeure en ce monde pour que les hommes continuent de l’implorer toujours, alors les méchants vivent plus longtemps, c’est logique. J’ai moi aussi décidé d’être méchant… (p. 35)
Tous ses petits compères le considèrent comme un dur difficile à cuire, un aîné qui montre le chemin et voit le diable avant que les autres ne l’aperçoivent. Ils bourlinguent ensemble, fomentent des coups ensemble, tâchent de subsister la main dans la main, jusqu’au jour où ils se font enrôler dans une milice parallèle. L’intention est belle : donner à entendre des voix d’enfants qui grenouillent sous nos pieds et que, tous les matins, nous changeons en potentiels bourreaux. Aucune leçon de morale en biais. Seulement un œil qui s’adonne à l’observation et une oreille qui écoute les bruits de la rue. L’auteure nous appelle à cet essentiel qui structure les hommes depuis des lunes : entendre et voir autour de soi pour mieux avancer.

Ziggy, Romuald Hazoumè (Bénin), 2015, The October Gallery (London), octobergallery.co.uk
Les deux dernières nouvelles peignent avec un certain brio l’écume des mauvais jours et du mauvais sang. Les moutons noirs et les têtes de Turc. On se promène avec l’auteure dans les repaires où gisent des âmes en souffrance : enfants mal aimés et vertement molestés pour ce qu’ils sont et ce qu’ils n’ont pas. Les noirceurs de l’être humain apparaissent par petites touches au détour d’un mot ou d’une phrase. On se sent assourdi et quasiment dégoûté. On se prend alors à rêver d’un autre monde, beau et tolérant, où le nain est sanctionné volontiers pour ses vices et non pour sa taille et où les laids ne rasent pas les murs de peur de se faire occire par ceux qui se voient comme bradpittants (néologisme du chroniqueur).
Commençons par Noiraud, le sacré môme aux oreilles pointues et aux yeux globuleux dont tout le quartier se moquait :
On avait été heureux d’apprendre que le fils tant attendu, l’unique garçon de la fratrie venait de naître. On s’était empressé, les bras chargés de cadeaux, d’aller voir la mère et l’enfant ; et qu’est-ce qu’on découvrait ? Un bébé même pas beau ! Sa mère le surnomme « Noiraud ». Elle lui pinçait délicatement les joues et énumérait ses défauts : Tu as une bouche toute moche ! Et ces gros yeux ! Et quelles oreilles ! (p.45)
Le pauvre passait presque pour un petit monstre aux yeux de ses pairs : il avait tout pris de son grand-père paternel. La suite de l’histoire nous en apprend un tas de choses étonnantes, les unes après les autres, sur les torts que peuvent engendrer les normes de la potabilité esthétique dans nos sociétés. Elles peuvent mener au meurtre. J’ai cru happer à travers l’histoire une double question que l’auteure se pose : sur quelles bases se repose notre conception de la beauté et en quoi celle-ci serait synonyme de vertu ?

Coursita, Romuald Hazoumè (Bénin), 2011, The October Gallery (London), octobergallery.co.uk
L’enfant de personne nous raconte les trombes d’une gamine non désirée, née d’une courte relation entre une dame distante et souriante, et un homme à femmes dont les unions maritales ne duraient pas bien longtemps, (p. 57)
Des trombes froides qui nous renseignent autant sur les fragilités de nos rapports à l’amour que sur les liens de consanguinité que s’emploient à promouvoir tous les jours les hommes. Une nouvelle efficace et très bien écrite. Une soudaine incursion dans l’univers pas toujours gai de la paternité, avec en prime cette parole de l’enfant innocente et moqueuse qui nous ramène à nos engagements de parents. Que dire de plus ? En somme, ce recueil de nouvelles, court et urgent, servi par une écriture belle et sincère, est une palette de petites noirceurs qui peu à peu éclairent nos âmes d’adultes. Un signe évident d’une écrivaine pleine de promesses et attentive aux affres de son temps.
Cher tout le monde, femmes, hommes et tant d’autres, en guise de conclusion musicale, Guy Alexandre Souda propose Wa wa wa, une berceuse interprétée par Marie-Cécile Maloumbi Mata.
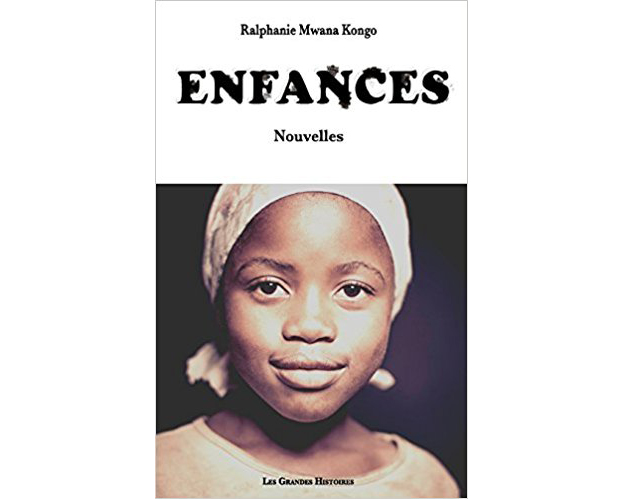



0 commentaires